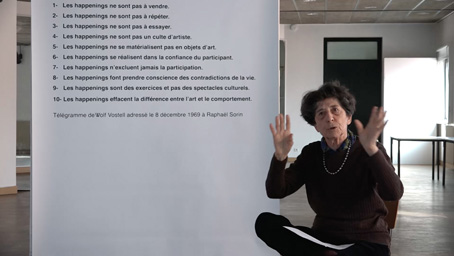publié dans "Xavier Veilhan Versailles", supplément n°359 d' Art press, septembre 2009, p.7-17.
Vous succédez à Jeff Koons à Versailles. Est-ce qu’investir un site aussi prestigieux, après l’un des artistes les plus en vue était difficile ? Est-ce que vous l’avez vécu comme un défi ?
Succéder à Jeff Koons, c’était un défi, oui, bien sûr. Mais relever des défis fait partie du travail des artistes. En même temps, c’était une chance car cela plaçait la barre plutôt haut. A Versailles, j’avais les moyens de démultiplier mon action. La question de l’échelle des sculptures s’est posée, mais justement c’est ce qui m’a stimulé. Jeff Koons a été un artiste très important pour moi. J’ai 45 ans, il en a 54. Les premières œuvres que j’ai vues de lui ont été un choc. D’une certaine manière, c’est un honneur de passer après lui.
Contrairement à Koons qui avait réactivé des pièces anciennes, vous avez créé de nouvelles sculptures que vous avez choisi de montrer en plein air, dans le parc.
Les oeuvres ne sont pas toutes à l’extérieur, deux sont à l’intérieur. Mais il est vrai que le parti pris de l’exposition est d’utiliser l’axe Est-Ouest qui traverse le château et le jardin pour placer les œuvres tout au long de cette ligne. Lors de mes visites, j’ai été étonné par la modernité des jardins. J’y ai vu un rapport à l’architecture mais aussi au Land Art et à des formes d’art paysager très contemporaines. Leur poésie ne demande qu’à être réactivée... Après tout, on pourrait dire que Le Nôtre a été le premier à réaliser des Earthworks ! Avec les milliers de mètres de cubes de terre qui ont été déplacés à Versailles, son projet était véritablement pharaonique, d'une dimension violente et radicale. Pourtant le résultat me semble doux, il produit une impression de légèreté à laquelle je suis sensible.
Justement par rapport à cette notion de légèreté, le faste du monument historique, avec ses galeries luxueuses, ses décors peints orchestrés par Le Brun, vous a-t-il gêné ?
Non. De Michel-Ange à Le Brun, j’aime bien ces rencontres entre l’architecture, la peinture, la décoration. L’idée de continuum entre l’aspect artistique, décoratif et fonctionnel m’intéresse aussi. Les figurations qu’orchestraient Le Brun sont plus ou moins lisibles pour les personnes qui, comme moi, ont peu de connaissances historiques, alors qu’il y a une évidence immédiate des jardins de Le Nôtre. Je suis aussi très intéressé par l’intérieur du château, tout en étant conscient qu’il s’agit d’une coquille relativement vide, malgré l’apparence de profusion. A cause des remaniements, des changements de politique, et autres revers qu’a subis le lieu, la forme qui subsiste aujourd’hui ne correspond qu’à notre époque. Je trouve cela assez beau. J’aime quand l’architecture échappe au programme et devient un contenant pour une autre histoire.
Le parcours commence avec cet étrange Carrosse et son attelage de six chevaux qui semblent déformés par la vitesse comme pour une sculpture futuriste. Ce dynamisme de chevaux au galop est très incongru, non seulement en raison de sa couleur violette, mais aussi à cause de votre façon si particulière de traiter la forme, de nous en donner une vision qui est à la fois générique et très technologique…
L’art, pour moi, c’est de faire émerger des choses dont on sait qu’elles existent, mais que l’on ne voit pas. Je veux créer des sortes de logotypes qui placent le spectateur devant un questionnement. Pour cela le recours au monochrome est un moyen essentiel. L’image du carrosse est très visible de loin mais elle se délite quand on s’en approche, elle nous interroge sur la légitimité de ce qu’on a vu. L’œuvre elle-même dans sa matérialité est déjà une image perçue, c’est comme si elle était le résultat d’une vision furtive ou déformée. Cette image du carrosse est presque le résumé de mon programme. Face à la réification de Versailles, que l’on tente de transformer en arrêt sur image, en sanctuaire, j’ai voulu réintroduire une certaine vie, un certain humanisme. Versailles est à la fois un instantané figé et extrêmement dynamique. C’est un lieu de projection et de diffusion du pouvoir, et en même temps un organisme dont la forme pourrait être comparée à celle d’un corps. Dans le tracé du parc, je vois beaucoup de similitudes avec un corps humain, en raison de la symétrie qui n’est qu’apparente.
Sur le même axe, on rencontre successivement la toute petite Femme nue puis Le Gisant beaucoup plus grand. Puis, on est confronté aux figures sombres des Architectes, à une image anamorphosée de la Lune et au Jet d’eau. Ce faisant, vous ne contrariez pas la géométrie de l’architecture de Louis Le Vau et des jardins à la française de Le Nôtre. Au contraire, vous semblez reprendre à votre compte les illusions de perspective, jouer avec les artifices optiques et adopter en quelque sorte le point de vue du roi… Au fond, derrière tout ça, se pose la question de la représentation et du pouvoir (pouvoir du roi, pouvoir conféré momentanément à l’artiste)…
Les problèmes liés à la représentation, à la perspective et à la symétrie ont toujours suscité ma curiosité. Versailles est justement un temple de la géométrie et de la perspective. Je me suis documenté sur l’architecture des jardins, je me suis intéressé au parallèle que Louis Marin a établi entre le plan du jardin de Versailles et celui du parc d’attractions de Disneyland.
A Versailles, on ressent un choc visuel comparable à celui qu’on peut avoir à la plage ou sur une piste de ski : une forte présence des éléments (air, eau, terre, lumière), une dimension de plein air, des étendues à perte de vue. Il s’agissait pour moi de prendre ce parc à bras-le-corps, mais sans volonté de provocation. Je ne voulais pas non plus me placer dans une position de retrait, mais plutôt accompagner ce mouvement qui a été initié par Louis XIV et Le Vau, Le Brun, Le Nôtre. D’ailleurs, je considère que mon intervention est plutôt classique. Plus on est près du Château, plus on ressent la puissance du pouvoir royal. Plus on s’en éloigne, plus on se retrouve seul dans un jardin aux dimensions incroyables : au-delà du Grand Canal, on parvient à une forêt, avec des vrais animaux. J’ai voulu accompagner ce mouvement avec des pièces, qui dans leur échelle et dans leur nature, donnent l’impression de se fondre dans l’environnement. A la fin du parcours, Le Jet d’eau correspond à un crescendo puisqu’il arrive à une hauteur de 100 mètres, mais en même temps, la notion d’auteur tend à s'y dissoudre. Je pense que les passants qui verront ce jet d’eau ne se poseront pas la question de son auteur. Finalement peu importe qui a fait quoi. J’aime assez cette idée d’une influence diffuse, qui me semble proche de la notion d’auteur en architecture.
Revenons au Mobile et à la Light machine qui sont les deux seules pièces décentrées par rapport à l’axe que vous avez retenu. Les raisons sont-elles d’ordre technique ?
Il y avait des contraintes liées à la visibilité des oeuvres mais aussi aux parcours des visiteurs, qui peuvent varier en fonction des jours et des ouvertures de salles. Avec le scénographe Alexis Bertrand qui a travaillé avec moi sur la réalisation des pièces, nous nous sommes interrogés : comment faire un parcours perceptible, comment rendre le propos artistique lisible lorsque l’on sait que les visiteurs, majoritairement étrangers, ne s’attendent pas à voir une exposition d’art contemporain ? Il fallait préserver le caractère universel du lieu. Mon travail est de faire des expositions plutôt que des œuvres. Je m’intéresse plus à ce que les gens vont ressentir, qu’à ce que je veux dire ou exprimer. Bien sûr, les réactions du public sont difficiles à évaluer. Je dirai même que c’est impossible. Je suis à la recherche d’une chose qui est sans cesse en train de m’échapper… Pourtant, si trois personnes s’entendent pour dire que cette forme est celle d’un verre ou d’un avion, cela devient un verre ou un avion. C’est sans doute pourquoi mes œuvres sont à la fois si précises et si ouvertes.
Pour Versailles, vous reprenez des thématiques qui structurent votre travail depuis longtemps : les moyens de locomotions, la statuaire, les mobiles et les tableaux lumineux. Mais les animaux de votre bestiaire favori (rhinocéros, ours, lions et autre monstres surdimensionnés) semblent avoir disparu… La statuaire et le nu auraient-ils pris le pas sur les animaux ?
Les chevaux de l’attelage du Carrosse sont tout de même présents et ils sont pour moi une sorte de négatif de l’homme : on peut les chevaucher, les formes animales et humaines peuvent s’emboîter. Dans l’attelage qui est un moyen de transport et un objet construit, je vois aussi une forme organique domestiquée. Je suis parti de la réflexion de Bruno Latour : façonnons-nous les objets qui nous entourent ? Quelles contraintes économiques conduisent à la création d’une forme plutôt qu’une autre. Mon travail procède par cercles concentriques. L’homme est au centre. Je m’en suis approché timidement avec les objets, puis les êtres vivants. Je suis passionné par le caractère anthropomorphique des animaux et leur facultés de perception qui ne sont pas semblables aux nôtres. Mais à Versailles, je me suis davantage posé la question de l’humain et même du surhumain.
Est-ce que ce ne serait pas un peu la suite de la réflexion engagée pour l’exposition Contrepoint au Musée du Louvre en 2005 ?
Oui, c’est très juste. Au Louvre, j’avais réfléchi au problème de la célébration : qui est illustre ? Qui célébrer ? J’avais présenté sept personnages illustres et…la chienne Laïka. Je suis passionné par la conquête spatiale. Lorsqu’elle fut envoyée seule dans l’espace, Laïka était une sorte de représentant de l’humanité mais on savait aussi qu’elle ne reviendrait pas. Je voulais prolonger cette idée de conquête et la lier à celle du destin de l’homme, en représentant Youri Gagarine. Le cosmonaute prend la forme d’un gisant, ce qui peut paraître un peu désenchanté, mais on sait que son destin a été sombre. Il a été instrumentalisé par le pouvoir. Il est devenu un corps politique. Pourtant, il a été le premier homme à voir la Terre comme un objet, il a été le premier à vérifier que ce n’était qu’un objet parmi les autres. J’avais la vision de ce cosmonaute comme un corps éclaté, composé de multiples pièces assemblées, avec cette idée que nous sommes les hôtes des matières qui nous constituent et qui constituent l’espace. Ce gisant est comme un mannequin d’anatomie, qui exhibe des éléments intérieurs et extérieurs.
Contrairement au cosmonaute qui est quand même en fâcheuse posture, les architectes qui sont perchés sur leurs socles forment un ensemble compact d’hommes et de femmes illustres que vous présentez du plus jeune au plus âgé. Pouvez expliquer la technique qui vous a permis de saisir leur contour ?
Nous avons recours aux scanners parfois utilisés en architecture pour obtenir des relevés de plusieurs millions de points, qui servent à créer des polygones. Ces nuages de points sont obtenus en plaçant les personnes sur un plateau amovible, entre trois scanners, et en les faisant tourner sur eux-mêmes d’un 1/8° de tour à chaque nouvel enregistrement. Les données sont ensuite recomposées comme si on recollait les éléments d’un vase brisé. Après cela, on baisse ou on augmente la définition de l’image, ce qui permet d’obtenir un volume plus ou moins précis, plus ou moins dessiné au moment de l’usinage : des hommes dirigent des machines, ils opèrent ce passage à la réalité en transcrivant les fichiers informatiques dans divers matériaux (bois, polystyrène...). Au départ, cela se rapproche de la technique photographique et des travaux scientifiques d’Etienne Jules Marey, sauf que nous ajoutons la troisième dimension. La séance de scan dure environ quarante-cinq minutes, il y a beaucoup d’analogies avec les débuts de la photographie où les poses étaient très longues. Je demande aux personnes de se placer de la façon qui leur convient le mieux. Là, onn n’est plus du tout dans la culture du snap shot. Les architectes constructeurs à qui je me suis adressé ont bien compris cela et ils se sont prêtés au jeu très sérieusement.
Une autre sculpture a été réalisée avec cette technique, il s’agit de cette femme nue que vous dites « plantée comme une aiguille d’acupuncteur dans la Cour Royale » ! Est-elle un clin d’œil aux allégories de l’abondance, de la paix, de la peinture, etc…qui sont incarnées par des statues de femmes souvent dénudées ? Est-ce une façon de répondre à l’abondance symbolique du décor sculpté ?
Par rapport à l’échelle du lieu, j’ai voulu que ce personnage en alliage de bronze et manganèse soit très petit, mais il est placé à un point de croisement essentiel, où la géométrie et la géographie (des avenues) se rejoignent. Le sujet et les dimensions de cette sculpture sont liés aux notions de permanence et d’impermanence du corps. Avec ce nu, j’aborde un thème fondamental : Le Bernin, Poussin, Manet, Courbet, Newton ont représenté le nu de façon très différente, je voulais réactualiser cette question. Il a été difficile de choisir un modèle. Finalement nous avons scanné et assemblé trois corps de femmes différents pour obtenir ce corps contemporain. Je souhaitais désamorcer le fantasme du modèle fusionnel que l’on trouve, par exemple chez Picasso, et travailler sur les notions d’apparence et de distance. Il s’agit de la projection d’un standard contemporain, car bien sûr, le corps générique parfait n’existe pas.
A Versailles, vous privilégiez le jardin et la question du rapport à l’Histoire. Lors de la première édition de La Force de l’Art, vous aviez créé votre propre podium et exposé les sculptures d’autres artistes (Le Baron de Triqueti, Cesar, Séchas…) Vous assumez les rôles d’artiste, de commissaire d’exposition et de scénographe. Est-ce que cela vient d’une méfiance par rapport aux formes modernes de l’exposition ?
Non, je me repose sur ce qui a été fait pour aller plus loin. Je suis un fan d’artistes, je suis aussi collectionneur. Je cherche plutôt à déplacer la position habituelle de l’artiste, tout en étant conscient qu’il existe une histoire de l’exposition : depuis les expositions universelles, et jusqu'à Quand les attitudes deviennent formes (1969), ou Chambres d’amis (1986)… les propositions ont été très différentes. Pour moi, il n’y a pas de fin. L’exposition est comme un paysage dans lequel on se promène et qui ne s’arrête pas. Il suffit d’aller plus loin pour voir autre chose.
Rechercher dans ce blog
lundi 28 septembre 2009
mardi 28 avril 2009
peintures réalistes, allers et retours
Texte proposé pour l'exposition Un siècle de Réalismes dans la peinture en France, MASP, Sao Paulo, printemps 2009.
Bien qu’il ait revendiqué cette étiquette lors d’une exposition personnelle (1) en 1855, le réalisme n'a pas été inventé par Gustave Courbet. Ni par François Millet ou Honoré Daumier d’ailleurs ! Au XVII° siècle déjà, des artistes tels que Georges de la Tour et les frères Le Nain représentaient avec méticulosité des scènes de la vie quotidienne, ce qui ne les empêchaient pas de transposer des thèmes bibliques ou mythologiques en recourant à l’iconographie de leur époque. Ces mêmes artistes s’étaient intéressés à la précision et à la sobriété de la peinture flamande, ils peignaient en respectant le système perspectif inventé par la Renaissance italienne.
LA NATURE D’UNE LIAISON IMPOSSIBLE
Dès que l’on évoque le réalisme au XIX° siècle, l’imposante carrure de Gustave Courbet, le peintre paysan, vient prendre toute la place, et l’on passe généralement sous silence une artiste qui est née seulement trois ans après lui : Rosa Bonheur. Ces deux là ont pourtant quelques affinités. Ils ont représenté le monde paysan au grand air et en grands formats, comme s’il peignaient les héros d’une peinture d’histoire. Ils ont peint les animaux de la ferme, les pâturages et les gardiens de troupeaux, les fenaisons, les foires et les concours agricoles, les travaux artisanaux des hommes, des femmes et des enfants. Il l’ont fait en générant une sorte d’allégorie du labeur et de la vie simple qui transmettait un discours qui n’avait rien de nostalgique, ni de réactionnaire, mais qui n’en était pas moins politique.
Rosa Bonheur, connue pour son homosexualité et son mode de vie peu commun (son père fut Saint-Simonien (2)) et Gustave Courbet, ami de l’anarchiste Pierre Joseph Proudhon, se sont intéressés aux animaux sauvages comme aux animaux domestiqués. Gustave, le chasseur, qui est resté fidèle aux paysages et aux paysans de sa Franche-Comté, a peint d’innombrables scènes d’hallali. Rosa, qui vécut une grande partie de sa vie au château de By près de Fontainebleau, passait sans problème de la représentation d’un bison ou d’un lion (elle en avait deux en cage) à celle d’un veau dans la campagne nivernaise ! Un autre point commun les réunit qui n’a sans doute pas été évalué à sa juste valeur : pour ces artistes, le recours à la photographie comme source iconographique des peintures était une évidence non discutable dans la mesure où ils se cantonnaient, comme Baudelaire l’a écrit, à utiliser la photographie comme conseil, sans subir l’aliénation de la machine. D’autres peintres ont emprunté cette voie photographique (on pourrait même dire cette autoroute, si ce n’était un anachronisme), et ils sont fort nombreux rien qu’au XIX° siècle : Delacroix, Degas, Manet, Fantin-Latour, Caillebotte, Khnopff (3) … En tous cas, l’usage de la photographie, technique nouvelle au XIX° siècle, permet de tordre le cou à l’idée que des artistes « animaliers » tels que Bonheur et Courbet étaient en quête d’un âge d’or perdu qui précéderait la Révolution Industrielle…Chacun à sa façon, ils surent trouver une clientèle fidèle, pour qui ils pouvaient facilement faire la réplique d’une œuvre.
LES NUS, TOTEMS ET TABOUS
Mais réaliste ne veut pas seulement dire conforme au réel, ou à un certain enregistrement du réel. Tout en « représentant des objets tangibles et visibles pour l’artiste » (4), une œuvre réaliste peut receler une symbolique cachée, elle peut être l’objet d’un investissement fantasmatique. Ainsi, par-delà les années, La femme nue au chien de Courbet (en fait un portrait de Léontine Renaude, qui fut sa maîtresse) peut être rapprochée des Femmes au bull-dog de Picabia. On ne s’étonnera guère non plus, de trouver un autre petit chien, symbole de la fidélité mais aussi de la sexualité, aux pieds de l’ambiguë Baigneuse que Renoir peignit en 1870...
Tandis que Courbet puisait l’inspiration dans sa collection de clichés pornographiques interdits, Picabia peignait ses nus réalistes (1942-45) à partir de l’association de différentes photographies publiées dans des revues de charme. Bien que ces peintures soient séparées par plus de quatre-vingt années, elles ont des points communs, thématiques et formels. A chaque fois, les naïades sont exhibées sans aucun prétexte mythologique (ce ne sont pas des divinités du panthéon grec) et avec une certaine complaisance que personne ne trouvait coupable, étant donné que les commanditaires et les peintres étaient de sexe masculin.
Pendant longtemps, pour les femmes qui avaient du mal à se faire admettre dans les cours de dessins ou de beaux-arts, la représentation de la nudité fut frappée d’anathème. C’est pourquoi les nus masculins et féminins de Suzanne Valadon ne manquent pas de surprendre. Pendant les années folles, quand triomphaient les garçonnes, elle livrait le regard unique d’une artiste qui fut aussi modèle pour d’autres peintres (5). Quelque peu outrancier, son Grand nu au tableau de 1922, montre une femme fière de son corps, le bras campé sur la hanche, qui retient ou peut-être tend derrière elle une étoffe verte, dans un geste provocateur comparable à celui d’un torero faisant une passe. L’audace de Valadon est désarmant. En 1931, à plus de soixante ans elle osa se représenter nue dans un portrait en buste sans concession.
Sujet d’étude académique et rétrograde par excellence lorsqu’il est étudié d’après les plâtres anciens, le nu d’après modèle vivant fut longtemps réservé aux hommes. En ce sens, c’est « une des grandes conquête des femmes artistes au XX° siècle » (6). Anita Malfatti l’avait compris, elle qui transgressa le tabou : avant la Première Guerre mondiale, elle fut la seule artiste brésilienne qui osa peindre des nus masculins et féminins. Cette femme d’exception, avant-gardiste éclairée qui avait voyagé et étudié à Berlin et New York était consciente de la provocation qu’elle adressait aux peintres traditionalistes. Elle sélectionna ses œuvres et ne présenta pas ses nus masculins de facture cubiste lors de son exposition personnelle en 1917 à Sao Paulo, ce qui ne l’empêcha pas d’être éreintée par la critique... Oswald de Andrade prit sa défense en mettant en cause le « préjugé photographique » qui aveuglait ses contemporains : au contraire, affirmait-il, les « travaux apparemment extravagants » de Malfatti sont « la négation de la copie, l’horreur de la peinture léchée » (7).
ROMANTISME I : INDIENS, COW BOY ET CHASSEUR DE LIONS
Le réalisme de ces artistes se situe au carrefour de problématiques différentes et complexes : formelles car elles introduisent malgré tout des renouvellements stylistiques et même des ruptures dans la tradition ; politiques parce que ces représentations que tout à chacun peut comprendre et partager, dissimulent un autre niveau de compréhension, et de projection imaginaire. Récemment Olivier Rolin (8) a brodé tout un récit autour du fameux Pétuiset, chasseur de lions conservé au MASP de Sao Paulo. En effet, cette œuvre, qu’Edouard Manet peignit en 1881, surprend par son cadrage qui relègue au dernier plan, derrière un tronc d’arbre, la carcasse du grand fauve abattu. Vêtu de l’habit noir en vogue au XIX° siècle, Pétuiset ne ressemble guère à un redoutable chasseur. On dirait plutôt un élégant notable, avec son couvre-chef à plume et sa chemise blanche. Il prend la pose, une jambe à terre, et nous regarde, au lieu de viser ! C’est comme si le peintre insinuait que son modèle n’était qu’un poseur et que son trophée de chasse était une carpette d’appartement complètement inoffensive.
A l’inverse, parce qu’il est traité en héros, on peut s’interroger sur le portrait équestre triomphant de Buffalo Bill en 1889. Il semble en décalage complet avec la « production animalière », les chiens, chevaux, veaux, vaches et moutons qui constituaient les commandes habituelles de Rosa Bonheur… Par son sujet, son traitement et son format, ce portrait de cow-boy (véritable figure mythique de la conquête guerrière de l’Ouest) est très différent des paysans laborieux qu’elle a représentés dissimulés derrière leurs vaches, en 1849, dans Le Labourage nivernais. Tout puissant, le peintre réaliste peut servir le mythe ou le défaire. Il peut transformer un sujet en héros (9) ou en humble idiot.
ROMANTISME II, LES FOUS ET LA POLITIQUE
Il est vrai aussi que le portrait pictural pose d’autres questions. De Jan Van Eyck à nos jours, ce genre semble traverser les siècles en se jouant des catégorisations et de la succession des mouvements. Ainsi, le portrait qu’Anne Louis Girodet fit du député Belley (1797) est indéniablement réaliste. Les portraits d’aliénés (1822) de Théodore Géricault le sont aussi, même si ces deux artistes sont des représentants fameux du romantisme pictural. Par leurs sujets, ces portraits sont exceptionnels et leur approche est complexe : première et unique représentation d’un député noir français, le portrait de Jean-Baptiste Belley fut peint l’année où il fut nommé chef de la gendarmerie qui luttait contre les troupes indépendantistes de Toussaint-Louverture à Saint-Domingue. C’est la représentation d’un fidèle serviteur de la République, qui avait voté l’abolition de l’esclavage pendant la Convention, mais qui refusait l’autonomie des colonies. Les dix portraits de monomaniaques servaient une tout autre intention puisqu’ils furent commandés à Géricault par le docteur Georget, pour servir l’étude de la médecine. Pour la première fois, la peinture d’un grand artiste servait à documenter certains traits psychologiques jugés pathologiques. Ces portraits interviennent après la Révolution française, dans des périodes de trouble esthétique et éthique où les valeurs vacillent : pour servir la République, un homme noir peut trahir les siens tout en croyant les défendre ; la folie peut être caractérisée et analysée, elle peut s’exprimer (ou se dissimuler) dans un visage…
On le comprend, l’idée rassurante que le réalisme pictural de Courbet s’oppose frontalement au romantisme ne peut résister à l’examen de ses œuvres de jeunesse : ses autoportraits en Homme blessé -ou en Désespéré guetté par la folie- suivaient le chemin tracé par Géricault. Comme lui, Courbet s’était intéressé aux théories physiognomoniques de Lavater. Courbet a aussi peint des opposants politiques (Jules Vallès et surtout Proudhon…) qui reflétaient ses opinions politiques. Son portrait de Pierre Dupont (auteur du « Chant ouvrier » de 1848) lui fut même confisqué par les autorités du Second Empire.
PORTRAITS DE FEMMES
En avons-nous vraiment fini avec la crise des valeurs romantiques ? En 1904, en tous cas, le portrait de la chanteuse wagnérienne Suzanne Bloch par Picasso trahissait la survivance de cet état d’esprit. Le style est réaliste, mais en même temps, on sent bien que le jeune artiste est encore sous l’influence des peintres symbolistes fin de siècle, en quête d’une beauté féminine idéale. La persistance des théories du Gesamtkunstwerk (union de tous les arts) qui fondent les opéras de Wagner est latente.
Deux ans plus tard, en 1906, c’est une égérie bien différente que Picasso représente : la Californienne Gertrude Stein, amie d’Alice Toklas, qui joua un rôle important auprès des artistes d’avant-garde, puis des peintres néo-humanistes en Europe. Gertrude, qui dut s’astreindre à de nombreuses et longues séances de pose (10), fut-elle satisfaite de ce visage au regard déséquilibré où l’on sent déjà poindre la nouvelle manière de Pablo issue de sa connaissance de l’art ibérique et de la statuaire africaine ? Toujours est-il qu’en 1933, elle demanda son portrait à Francis Picabia et à Tal Coat qui la représentèrent chacun de façon frontale et non de trois quarts ! On peut trouver une certaine similitude entre ces deux représentations. Même simplification du traitement plastique. Même buste massif de l’écrivain qui était une autorité dans le monde littéraire ainsi que son autobiographie visait à le démontrer (11). Même visage aux cheveux très courts et aux yeux peu expressifs (voir inexpressifs alors que son regard était très assuré sur les photographies de l’époque). Stein est une intellectuelle. Ce n’est pas une muse, pas une maîtresse, ni la femme d’un notable. Indéniablement l’exécution de ses commandes posa quelques problèmes aux peintres !
LE RÉALISME EST-IL RÉACTIONNAIRE (12) ?
En revanche, il est des cas où la peinture réaliste ne délivre qu’un discours idéologique qui l’apparente purement et simplement à de la propagande politique. Des exemples de cet autoritarisme figuratif qui conduisait à ériger un mode de vie patriotique en modèle ou à transformer un vulgaire leader politique en incarnation divine ont été tournés en dérision par le peintre Erro. Entre 1965 et 1980, celui-ci a repris des affiches, des photos et des peintures des différentes propagandes nazie pétainiste et maoïste. Il les a associé à des images de conflits guerriers de l’actualité de son temps pour en faire la base de tableaux parodiques.
On le sait, dès 1933, la propagande politique du régime hitlérien portait aux nues les académies de Ferdinand Spiegel et d’Arno Brecker(13) qui valorisaient la force, l’ordre et la patrie. Elle stigmatisait et rejetait comme dégénérées toutes les recherches créatives de l’avant-garde internationale et menaçait la vie de leurs auteurs obligés à l’exil.
En France, les historiens ont souvent parlé d’un « retour à l’ordre », dont les caractéristiques principales étaient justement le recours aux traditions nationales, la volonté de renouer avec le métier des peintres anciens, l’artisanat et le dessin. Ils ont généralement situé ce « retour » en 1919, au moment où André Lhote et Roger Bissière, cubistes repentis, s’étaient fait les chantres d’un idéal néo-classique qui passait par Fouquet, Poussin, Chardin, Corot et surtout Ingres, dont André Derain disait qu’il était « le grand incompris »(14). On a souvent fait de Picasso le pionnier de cette attitude, au moment de sa « période ingresque » de 1918, lorsqu’il peignait des portraits classiques de sa future épouse, la danseuse russe Olga Khokhlova. Pourtant, l’Espagnol avait opéré des retours ponctuels à la figuration réaliste dès 1914. Et surtout, on sait aujourd’hui que ces portraits étaient peints d’après photographie et que Picasso n’allait sûrement pas en rester là !
En fait, cette périodisation de l’histoire de l’art repose sur une vision déterministe : l’année 1919 serait celle d’une rupture consécutive au traumatisme de la Première Guerre mondiale. On évoque aussi pour étayer cette thèse, les textes prônant un « retour au métier » qui furent publiés par Giorgio de Chirico en Italie, dans la revue Valori Plastici entre 1919 et 1920. Mais l’artiste n’avait-il pas déjà amorcé ce retour quand il peignait ses œuvres métaphysiques à partir de sa lecture des œuvres d’Arnold Böcklin ? Nostalgique jusqu’à en perdre le sens de la mesure, il a cultivé ce fantasme impossible de retour au métier jusqu’à la fin de sa vie (en 1976). Il a cherché en vain à retrouver la technique des maîtres italiens, allemands, flamands, français… et a consacré son seul essai d’histoire de l’art à …Gustave Courbet en qui il voyait l’incarnation du génie romantique. Si on ajoute à cela, son rejet haineux de l’avant-garde et de cette peinture moderne (15) qu’il avait pourtant contribué à modifier durablement, on devine les fortes contradictions qui tenaillaient l’Italien.
Dans la carrière des grands artistes, les moments de recherche, les ruptures et les retours (à la figuration, au dessin, aux modèles du passé…) se succèdent fréquemment, sans qu’il soit possible de leur attribuer un sens idéologique définitif, que celui-ci soit « réactionnaire » ou « progressiste ». En fonction du regardeur et du contexte historique, le nu ou le portrait réalistes sont des genres rétrogrades ou révolutionnaires, des expressions féminines ou viriles. Dans bien des cas, la résistance aux courants dominants génère une aptitude à la contradiction : Francis Picabia, qui s’était moqué des « portraits Kodak » de Picasso, fut aussi le roi des revirements, de l’éclectisme pictural et du travail d’après photographie ! Nombreuses, ses volte-face se jouaient prioritairement dans une tension entre abstraction et figuration.
Le parcours d’un véritable artiste, un artiste qui cherche, ne doit pas être vu dans une optique diachronique, mais plutôt comme une succession d’allers et retours qui entrent en résonance avec les tendances de son époque, tout en répondant à ses motivations intimes. Pour toutes ces raisons, ces allers et retours échappent grandement aux catégories esthétiques qui limitent notre entendement.
NOTES
(1) Pour l’exposition universelle de 1855, Courbet peignit L’atelier, donnant une représentation allégorique et réelle de sa vie d’artiste. Le tableau fut refusé par le jury en même temps que L’enterrement à Ornans et Les Baigneuses, tandis qu’onze autres œuvres étaient acceptées. Par réaction, Courbet décida de construire, avec l’aide financière de son protecteur Alfred Bruyas, un pavillon situé avenue Montaigne à Paris. Le catalogue de cette exposition présentait quarante tableaux et dessins de Courbet et contenait son manifeste du réalisme, en fait une lettre expliquant ses théories artistiques à ses élèves (le titre fut donné ultérieurement par Castagnary).
(2) Raymond Bonheur était lui-même artiste, il dirigeait un atelier et avait donné des cours à sa fille. Voir Catherine Gonnard, Elisabeth Lebovici, Femmes artistes, artistes femmes, Hazan, 2007, p. 25.
(3) Voir Aaron Scharf, Art and Photography, Penguin books, 1968.
(4) Gustave Courbet, « Manifeste du réalisme » , 1855.
(5) Catherine Gonnard, Elisabeth Lebovici, Femmes artistes, artistes femmes, op. cit. p. 55.
(6) Marie-Jo Bonnet, Les femmes dans l’art, Editions de la Martinière, 2004, p. 148.
(7) Oswald de Andrade, « L’exposition Anita Malfatti », Jornal do Comércio : « Notes sur l’art », Sao Paulo, 11 janvier 1918.
(8) Voir Olivier Rolin, Un chasseur de lion, Seuil, 2008.
(9) Rosa Bonheur avait rencontré William Frederick Cody à Paris, lors de l’Exposition Universelle de 1889 où il montrait son campement indien ; elle avait peint sur place les chevaux et la troupe. En retour, Buffalo Bill était venu lui rendre visite au château de By. Pour l’artiste, qui possédait déjà des collections de photographies sur ce sujet, peindre des Indiens c’était s’inscrire dans une tradition qui, de Chateaubriand à Charles Baudelaire et Georges Catlin, valorisait le « bon sauvage ». A cette époque, Buffalo Bill n’était plus le sanguinaire tueur de bisons de la légende, mais l’organisateur et directeur du spectacle Buffalo Bill’s Wild West Show qui eut un franc succès en Europe et en Amérique du Nord. Ce portrait de commande, que l’on peut rapprocher de certaines affiches, était donc bien d’ordre promotionnel.
(10) Voir Gertrude Stein, Autobiographie d’Alice Toklas, Paris, Gallimard, 1934, p. 56.
(11) Dans l’Autobiographie d’Alice Toklas, op. cit., qui fut d’abord publié en 1933 aux Etats-Unis, Stein rédige elle-même son autobiographie par Alice Toklas, ce qui lui permet, bien peu modestement, de se placer sur un pied d’égalité avec les plus grands créateurs du XX° siècle qu’elle a pu rencontrer !
(12) Question qui me fut posée par Eric Corne, pour servir de point de départ à cet article.
(13) Cocteau vanta les mérites du sculpteur Arno Brecker dans la revue Comoedia en 1942. Au même moment, Maurice de Vlaminck et Maurice Utrillo (le fils de Suzanne Valadon) n’hésitaient pas à se rendre en Allemagne nazie pour un voyage d’étude alors que nul n’ignorait les persécutions que subissaient les artistes dits « dégénérés » comme Otto Dix, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Kurt Schwitters depuis 1933…Voir Laurence Bertrand Dorléac, Histoire de l’art, Paris, 1940-44, Editions de la Sorbonne, 1986, p. 83 et 95.
(14) Voir Jean Laude, « Le retour à l’ordre », Le retour à l’ordre dans les arts plastiques et l’architecture, 1919-1925, Université de Saint-Etienne, 1986, p. 24-27.
(15) Voir Giorgio de Chirico, Mémoires, La Table ronde, Paris, 1965.
Bien qu’il ait revendiqué cette étiquette lors d’une exposition personnelle (1) en 1855, le réalisme n'a pas été inventé par Gustave Courbet. Ni par François Millet ou Honoré Daumier d’ailleurs ! Au XVII° siècle déjà, des artistes tels que Georges de la Tour et les frères Le Nain représentaient avec méticulosité des scènes de la vie quotidienne, ce qui ne les empêchaient pas de transposer des thèmes bibliques ou mythologiques en recourant à l’iconographie de leur époque. Ces mêmes artistes s’étaient intéressés à la précision et à la sobriété de la peinture flamande, ils peignaient en respectant le système perspectif inventé par la Renaissance italienne.
LA NATURE D’UNE LIAISON IMPOSSIBLE
Dès que l’on évoque le réalisme au XIX° siècle, l’imposante carrure de Gustave Courbet, le peintre paysan, vient prendre toute la place, et l’on passe généralement sous silence une artiste qui est née seulement trois ans après lui : Rosa Bonheur. Ces deux là ont pourtant quelques affinités. Ils ont représenté le monde paysan au grand air et en grands formats, comme s’il peignaient les héros d’une peinture d’histoire. Ils ont peint les animaux de la ferme, les pâturages et les gardiens de troupeaux, les fenaisons, les foires et les concours agricoles, les travaux artisanaux des hommes, des femmes et des enfants. Il l’ont fait en générant une sorte d’allégorie du labeur et de la vie simple qui transmettait un discours qui n’avait rien de nostalgique, ni de réactionnaire, mais qui n’en était pas moins politique.
Rosa Bonheur, connue pour son homosexualité et son mode de vie peu commun (son père fut Saint-Simonien (2)) et Gustave Courbet, ami de l’anarchiste Pierre Joseph Proudhon, se sont intéressés aux animaux sauvages comme aux animaux domestiqués. Gustave, le chasseur, qui est resté fidèle aux paysages et aux paysans de sa Franche-Comté, a peint d’innombrables scènes d’hallali. Rosa, qui vécut une grande partie de sa vie au château de By près de Fontainebleau, passait sans problème de la représentation d’un bison ou d’un lion (elle en avait deux en cage) à celle d’un veau dans la campagne nivernaise ! Un autre point commun les réunit qui n’a sans doute pas été évalué à sa juste valeur : pour ces artistes, le recours à la photographie comme source iconographique des peintures était une évidence non discutable dans la mesure où ils se cantonnaient, comme Baudelaire l’a écrit, à utiliser la photographie comme conseil, sans subir l’aliénation de la machine. D’autres peintres ont emprunté cette voie photographique (on pourrait même dire cette autoroute, si ce n’était un anachronisme), et ils sont fort nombreux rien qu’au XIX° siècle : Delacroix, Degas, Manet, Fantin-Latour, Caillebotte, Khnopff (3) … En tous cas, l’usage de la photographie, technique nouvelle au XIX° siècle, permet de tordre le cou à l’idée que des artistes « animaliers » tels que Bonheur et Courbet étaient en quête d’un âge d’or perdu qui précéderait la Révolution Industrielle…Chacun à sa façon, ils surent trouver une clientèle fidèle, pour qui ils pouvaient facilement faire la réplique d’une œuvre.
LES NUS, TOTEMS ET TABOUS
Mais réaliste ne veut pas seulement dire conforme au réel, ou à un certain enregistrement du réel. Tout en « représentant des objets tangibles et visibles pour l’artiste » (4), une œuvre réaliste peut receler une symbolique cachée, elle peut être l’objet d’un investissement fantasmatique. Ainsi, par-delà les années, La femme nue au chien de Courbet (en fait un portrait de Léontine Renaude, qui fut sa maîtresse) peut être rapprochée des Femmes au bull-dog de Picabia. On ne s’étonnera guère non plus, de trouver un autre petit chien, symbole de la fidélité mais aussi de la sexualité, aux pieds de l’ambiguë Baigneuse que Renoir peignit en 1870...
Tandis que Courbet puisait l’inspiration dans sa collection de clichés pornographiques interdits, Picabia peignait ses nus réalistes (1942-45) à partir de l’association de différentes photographies publiées dans des revues de charme. Bien que ces peintures soient séparées par plus de quatre-vingt années, elles ont des points communs, thématiques et formels. A chaque fois, les naïades sont exhibées sans aucun prétexte mythologique (ce ne sont pas des divinités du panthéon grec) et avec une certaine complaisance que personne ne trouvait coupable, étant donné que les commanditaires et les peintres étaient de sexe masculin.
Pendant longtemps, pour les femmes qui avaient du mal à se faire admettre dans les cours de dessins ou de beaux-arts, la représentation de la nudité fut frappée d’anathème. C’est pourquoi les nus masculins et féminins de Suzanne Valadon ne manquent pas de surprendre. Pendant les années folles, quand triomphaient les garçonnes, elle livrait le regard unique d’une artiste qui fut aussi modèle pour d’autres peintres (5). Quelque peu outrancier, son Grand nu au tableau de 1922, montre une femme fière de son corps, le bras campé sur la hanche, qui retient ou peut-être tend derrière elle une étoffe verte, dans un geste provocateur comparable à celui d’un torero faisant une passe. L’audace de Valadon est désarmant. En 1931, à plus de soixante ans elle osa se représenter nue dans un portrait en buste sans concession.
Sujet d’étude académique et rétrograde par excellence lorsqu’il est étudié d’après les plâtres anciens, le nu d’après modèle vivant fut longtemps réservé aux hommes. En ce sens, c’est « une des grandes conquête des femmes artistes au XX° siècle » (6). Anita Malfatti l’avait compris, elle qui transgressa le tabou : avant la Première Guerre mondiale, elle fut la seule artiste brésilienne qui osa peindre des nus masculins et féminins. Cette femme d’exception, avant-gardiste éclairée qui avait voyagé et étudié à Berlin et New York était consciente de la provocation qu’elle adressait aux peintres traditionalistes. Elle sélectionna ses œuvres et ne présenta pas ses nus masculins de facture cubiste lors de son exposition personnelle en 1917 à Sao Paulo, ce qui ne l’empêcha pas d’être éreintée par la critique... Oswald de Andrade prit sa défense en mettant en cause le « préjugé photographique » qui aveuglait ses contemporains : au contraire, affirmait-il, les « travaux apparemment extravagants » de Malfatti sont « la négation de la copie, l’horreur de la peinture léchée » (7).
ROMANTISME I : INDIENS, COW BOY ET CHASSEUR DE LIONS
Le réalisme de ces artistes se situe au carrefour de problématiques différentes et complexes : formelles car elles introduisent malgré tout des renouvellements stylistiques et même des ruptures dans la tradition ; politiques parce que ces représentations que tout à chacun peut comprendre et partager, dissimulent un autre niveau de compréhension, et de projection imaginaire. Récemment Olivier Rolin (8) a brodé tout un récit autour du fameux Pétuiset, chasseur de lions conservé au MASP de Sao Paulo. En effet, cette œuvre, qu’Edouard Manet peignit en 1881, surprend par son cadrage qui relègue au dernier plan, derrière un tronc d’arbre, la carcasse du grand fauve abattu. Vêtu de l’habit noir en vogue au XIX° siècle, Pétuiset ne ressemble guère à un redoutable chasseur. On dirait plutôt un élégant notable, avec son couvre-chef à plume et sa chemise blanche. Il prend la pose, une jambe à terre, et nous regarde, au lieu de viser ! C’est comme si le peintre insinuait que son modèle n’était qu’un poseur et que son trophée de chasse était une carpette d’appartement complètement inoffensive.
A l’inverse, parce qu’il est traité en héros, on peut s’interroger sur le portrait équestre triomphant de Buffalo Bill en 1889. Il semble en décalage complet avec la « production animalière », les chiens, chevaux, veaux, vaches et moutons qui constituaient les commandes habituelles de Rosa Bonheur… Par son sujet, son traitement et son format, ce portrait de cow-boy (véritable figure mythique de la conquête guerrière de l’Ouest) est très différent des paysans laborieux qu’elle a représentés dissimulés derrière leurs vaches, en 1849, dans Le Labourage nivernais. Tout puissant, le peintre réaliste peut servir le mythe ou le défaire. Il peut transformer un sujet en héros (9) ou en humble idiot.
ROMANTISME II, LES FOUS ET LA POLITIQUE
Il est vrai aussi que le portrait pictural pose d’autres questions. De Jan Van Eyck à nos jours, ce genre semble traverser les siècles en se jouant des catégorisations et de la succession des mouvements. Ainsi, le portrait qu’Anne Louis Girodet fit du député Belley (1797) est indéniablement réaliste. Les portraits d’aliénés (1822) de Théodore Géricault le sont aussi, même si ces deux artistes sont des représentants fameux du romantisme pictural. Par leurs sujets, ces portraits sont exceptionnels et leur approche est complexe : première et unique représentation d’un député noir français, le portrait de Jean-Baptiste Belley fut peint l’année où il fut nommé chef de la gendarmerie qui luttait contre les troupes indépendantistes de Toussaint-Louverture à Saint-Domingue. C’est la représentation d’un fidèle serviteur de la République, qui avait voté l’abolition de l’esclavage pendant la Convention, mais qui refusait l’autonomie des colonies. Les dix portraits de monomaniaques servaient une tout autre intention puisqu’ils furent commandés à Géricault par le docteur Georget, pour servir l’étude de la médecine. Pour la première fois, la peinture d’un grand artiste servait à documenter certains traits psychologiques jugés pathologiques. Ces portraits interviennent après la Révolution française, dans des périodes de trouble esthétique et éthique où les valeurs vacillent : pour servir la République, un homme noir peut trahir les siens tout en croyant les défendre ; la folie peut être caractérisée et analysée, elle peut s’exprimer (ou se dissimuler) dans un visage…
On le comprend, l’idée rassurante que le réalisme pictural de Courbet s’oppose frontalement au romantisme ne peut résister à l’examen de ses œuvres de jeunesse : ses autoportraits en Homme blessé -ou en Désespéré guetté par la folie- suivaient le chemin tracé par Géricault. Comme lui, Courbet s’était intéressé aux théories physiognomoniques de Lavater. Courbet a aussi peint des opposants politiques (Jules Vallès et surtout Proudhon…) qui reflétaient ses opinions politiques. Son portrait de Pierre Dupont (auteur du « Chant ouvrier » de 1848) lui fut même confisqué par les autorités du Second Empire.
PORTRAITS DE FEMMES
En avons-nous vraiment fini avec la crise des valeurs romantiques ? En 1904, en tous cas, le portrait de la chanteuse wagnérienne Suzanne Bloch par Picasso trahissait la survivance de cet état d’esprit. Le style est réaliste, mais en même temps, on sent bien que le jeune artiste est encore sous l’influence des peintres symbolistes fin de siècle, en quête d’une beauté féminine idéale. La persistance des théories du Gesamtkunstwerk (union de tous les arts) qui fondent les opéras de Wagner est latente.
Deux ans plus tard, en 1906, c’est une égérie bien différente que Picasso représente : la Californienne Gertrude Stein, amie d’Alice Toklas, qui joua un rôle important auprès des artistes d’avant-garde, puis des peintres néo-humanistes en Europe. Gertrude, qui dut s’astreindre à de nombreuses et longues séances de pose (10), fut-elle satisfaite de ce visage au regard déséquilibré où l’on sent déjà poindre la nouvelle manière de Pablo issue de sa connaissance de l’art ibérique et de la statuaire africaine ? Toujours est-il qu’en 1933, elle demanda son portrait à Francis Picabia et à Tal Coat qui la représentèrent chacun de façon frontale et non de trois quarts ! On peut trouver une certaine similitude entre ces deux représentations. Même simplification du traitement plastique. Même buste massif de l’écrivain qui était une autorité dans le monde littéraire ainsi que son autobiographie visait à le démontrer (11). Même visage aux cheveux très courts et aux yeux peu expressifs (voir inexpressifs alors que son regard était très assuré sur les photographies de l’époque). Stein est une intellectuelle. Ce n’est pas une muse, pas une maîtresse, ni la femme d’un notable. Indéniablement l’exécution de ses commandes posa quelques problèmes aux peintres !
LE RÉALISME EST-IL RÉACTIONNAIRE (12) ?
En revanche, il est des cas où la peinture réaliste ne délivre qu’un discours idéologique qui l’apparente purement et simplement à de la propagande politique. Des exemples de cet autoritarisme figuratif qui conduisait à ériger un mode de vie patriotique en modèle ou à transformer un vulgaire leader politique en incarnation divine ont été tournés en dérision par le peintre Erro. Entre 1965 et 1980, celui-ci a repris des affiches, des photos et des peintures des différentes propagandes nazie pétainiste et maoïste. Il les a associé à des images de conflits guerriers de l’actualité de son temps pour en faire la base de tableaux parodiques.
On le sait, dès 1933, la propagande politique du régime hitlérien portait aux nues les académies de Ferdinand Spiegel et d’Arno Brecker(13) qui valorisaient la force, l’ordre et la patrie. Elle stigmatisait et rejetait comme dégénérées toutes les recherches créatives de l’avant-garde internationale et menaçait la vie de leurs auteurs obligés à l’exil.
En France, les historiens ont souvent parlé d’un « retour à l’ordre », dont les caractéristiques principales étaient justement le recours aux traditions nationales, la volonté de renouer avec le métier des peintres anciens, l’artisanat et le dessin. Ils ont généralement situé ce « retour » en 1919, au moment où André Lhote et Roger Bissière, cubistes repentis, s’étaient fait les chantres d’un idéal néo-classique qui passait par Fouquet, Poussin, Chardin, Corot et surtout Ingres, dont André Derain disait qu’il était « le grand incompris »(14). On a souvent fait de Picasso le pionnier de cette attitude, au moment de sa « période ingresque » de 1918, lorsqu’il peignait des portraits classiques de sa future épouse, la danseuse russe Olga Khokhlova. Pourtant, l’Espagnol avait opéré des retours ponctuels à la figuration réaliste dès 1914. Et surtout, on sait aujourd’hui que ces portraits étaient peints d’après photographie et que Picasso n’allait sûrement pas en rester là !
En fait, cette périodisation de l’histoire de l’art repose sur une vision déterministe : l’année 1919 serait celle d’une rupture consécutive au traumatisme de la Première Guerre mondiale. On évoque aussi pour étayer cette thèse, les textes prônant un « retour au métier » qui furent publiés par Giorgio de Chirico en Italie, dans la revue Valori Plastici entre 1919 et 1920. Mais l’artiste n’avait-il pas déjà amorcé ce retour quand il peignait ses œuvres métaphysiques à partir de sa lecture des œuvres d’Arnold Böcklin ? Nostalgique jusqu’à en perdre le sens de la mesure, il a cultivé ce fantasme impossible de retour au métier jusqu’à la fin de sa vie (en 1976). Il a cherché en vain à retrouver la technique des maîtres italiens, allemands, flamands, français… et a consacré son seul essai d’histoire de l’art à …Gustave Courbet en qui il voyait l’incarnation du génie romantique. Si on ajoute à cela, son rejet haineux de l’avant-garde et de cette peinture moderne (15) qu’il avait pourtant contribué à modifier durablement, on devine les fortes contradictions qui tenaillaient l’Italien.
Dans la carrière des grands artistes, les moments de recherche, les ruptures et les retours (à la figuration, au dessin, aux modèles du passé…) se succèdent fréquemment, sans qu’il soit possible de leur attribuer un sens idéologique définitif, que celui-ci soit « réactionnaire » ou « progressiste ». En fonction du regardeur et du contexte historique, le nu ou le portrait réalistes sont des genres rétrogrades ou révolutionnaires, des expressions féminines ou viriles. Dans bien des cas, la résistance aux courants dominants génère une aptitude à la contradiction : Francis Picabia, qui s’était moqué des « portraits Kodak » de Picasso, fut aussi le roi des revirements, de l’éclectisme pictural et du travail d’après photographie ! Nombreuses, ses volte-face se jouaient prioritairement dans une tension entre abstraction et figuration.
Le parcours d’un véritable artiste, un artiste qui cherche, ne doit pas être vu dans une optique diachronique, mais plutôt comme une succession d’allers et retours qui entrent en résonance avec les tendances de son époque, tout en répondant à ses motivations intimes. Pour toutes ces raisons, ces allers et retours échappent grandement aux catégories esthétiques qui limitent notre entendement.
NOTES
(1) Pour l’exposition universelle de 1855, Courbet peignit L’atelier, donnant une représentation allégorique et réelle de sa vie d’artiste. Le tableau fut refusé par le jury en même temps que L’enterrement à Ornans et Les Baigneuses, tandis qu’onze autres œuvres étaient acceptées. Par réaction, Courbet décida de construire, avec l’aide financière de son protecteur Alfred Bruyas, un pavillon situé avenue Montaigne à Paris. Le catalogue de cette exposition présentait quarante tableaux et dessins de Courbet et contenait son manifeste du réalisme, en fait une lettre expliquant ses théories artistiques à ses élèves (le titre fut donné ultérieurement par Castagnary).
(2) Raymond Bonheur était lui-même artiste, il dirigeait un atelier et avait donné des cours à sa fille. Voir Catherine Gonnard, Elisabeth Lebovici, Femmes artistes, artistes femmes, Hazan, 2007, p. 25.
(3) Voir Aaron Scharf, Art and Photography, Penguin books, 1968.
(4) Gustave Courbet, « Manifeste du réalisme » , 1855.
(5) Catherine Gonnard, Elisabeth Lebovici, Femmes artistes, artistes femmes, op. cit. p. 55.
(6) Marie-Jo Bonnet, Les femmes dans l’art, Editions de la Martinière, 2004, p. 148.
(7) Oswald de Andrade, « L’exposition Anita Malfatti », Jornal do Comércio : « Notes sur l’art », Sao Paulo, 11 janvier 1918.
(8) Voir Olivier Rolin, Un chasseur de lion, Seuil, 2008.
(9) Rosa Bonheur avait rencontré William Frederick Cody à Paris, lors de l’Exposition Universelle de 1889 où il montrait son campement indien ; elle avait peint sur place les chevaux et la troupe. En retour, Buffalo Bill était venu lui rendre visite au château de By. Pour l’artiste, qui possédait déjà des collections de photographies sur ce sujet, peindre des Indiens c’était s’inscrire dans une tradition qui, de Chateaubriand à Charles Baudelaire et Georges Catlin, valorisait le « bon sauvage ». A cette époque, Buffalo Bill n’était plus le sanguinaire tueur de bisons de la légende, mais l’organisateur et directeur du spectacle Buffalo Bill’s Wild West Show qui eut un franc succès en Europe et en Amérique du Nord. Ce portrait de commande, que l’on peut rapprocher de certaines affiches, était donc bien d’ordre promotionnel.
(10) Voir Gertrude Stein, Autobiographie d’Alice Toklas, Paris, Gallimard, 1934, p. 56.
(11) Dans l’Autobiographie d’Alice Toklas, op. cit., qui fut d’abord publié en 1933 aux Etats-Unis, Stein rédige elle-même son autobiographie par Alice Toklas, ce qui lui permet, bien peu modestement, de se placer sur un pied d’égalité avec les plus grands créateurs du XX° siècle qu’elle a pu rencontrer !
(12) Question qui me fut posée par Eric Corne, pour servir de point de départ à cet article.
(13) Cocteau vanta les mérites du sculpteur Arno Brecker dans la revue Comoedia en 1942. Au même moment, Maurice de Vlaminck et Maurice Utrillo (le fils de Suzanne Valadon) n’hésitaient pas à se rendre en Allemagne nazie pour un voyage d’étude alors que nul n’ignorait les persécutions que subissaient les artistes dits « dégénérés » comme Otto Dix, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Kurt Schwitters depuis 1933…Voir Laurence Bertrand Dorléac, Histoire de l’art, Paris, 1940-44, Editions de la Sorbonne, 1986, p. 83 et 95.
(14) Voir Jean Laude, « Le retour à l’ordre », Le retour à l’ordre dans les arts plastiques et l’architecture, 1919-1925, Université de Saint-Etienne, 1986, p. 24-27.
(15) Voir Giorgio de Chirico, Mémoires, La Table ronde, Paris, 1965.
vendredi 27 mars 2009
giorgio de chirico, mesure et démesure
"Giorgio de Chirico", Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 13 février-24 mai. Publié dans Art press n° 355, avril 2009, p.81-83.
Comment Chirico est-il perçu par les artistes aujourd’hui ? Quels liens établissent-ils avec leurs œuvres ? Dans le catalogue de l’exposition Giorgio de Chirico, la fabrique des rêves au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, on ne dispose que de quatre témoignages. C’est peu. Publiés récemment par le même musée, Raoul Dufy, le plaisir en livrait sept ; Francis Picabia, singulier idéal quatorze. De nos jours, les artistes hésitent encore (est-ce une question de génération ?) à remettre en question le clivage entre le « bon » Chirico de la Metafisica et le « mauvais » qui vint ensuite. Pour Télémaque, l’Italien s’est égaré sous l’influence du peintre Nicola Locoff. Au contraire, Bernard Dufour pense qu’il fait partie des « héros » qui sont « allés au bout d’eux-mêmes » et Konrad Klapheck ose avouer, contre ses amis surréalistes, que certains tableaux du « Chirico tardif » l’ont profondément touché. Seul Giulio Paolini revendique l’influence du « maître » à qui il rend hommage avec son Intérieur métaphysique présenté à la galerie Yvon Lambert.
Pourquoi une œuvre d’art ou une période donnée sont-ils reconnus et appréciés, alors que l’autre est bannie ? Chirico a dénoncé les « combines » des critiques et des marchands qui rejetaient ses nouvelles peintures. Ses règlements de compte haineux (1) peuvent être rapprochés de certains écrits journalistiques de Francis Picabia (2). Plus tard Philip Guston (3), un autre rebelle, fut l’un des rares artistes à défendre l’ensemble du travail de Chirico et à revendiquer son influence. Chirico est mort à l’âge de 90 ans, en 1978, il a donc traversé le vingtième siècle en continuant à peindre malgré l’acrimonie des surréalistes qui lui reprochaient son retour aux références classiques.
A cet égard, est-il convaincant de distinguer « trois catégories : la peinture métaphysique, le retour à la peinture traditionnelle, la reprise de la peinture métaphysique »(4)? Une telle vision fait l’impasse sur les phénomènes cycliques de retours qui travaillent quasiment chacune des peintures. Chirico, l’élu, le voyant est aussi l’artiste de la rumination. Rumination désabusée d’un idéal antique. Rumination des peintures fin de siècle d’Arnold Böcklin et de celles, foncièrement novatrices des primitifs italiens. En 1928, le maître qui rédige son « Petit traité technique de peinture » est aussi, paradoxalement, le provocateur qui met en scène des meubles monumentaux occultant le paysage, ou encore des gladiateurs débiles, des anti-héros ridiculement grands pour les intérieurs où ils livrent bataille. Tout en poursuivant son idéal technique (retrouver le métier des Anciens) et en fulminant contre l’art moderne, Chirico a réalisé une galerie d’autoportraits parodiques qui sont des attaques contre la figure et le rôle même du peintre : en notable de la Renaissance, en gentilhomme costumé, en vieille homme revêche assis nu sur une chaise, et même en torero farouche ! Or, dans sa jeunesse, à l’instar de Duchamp et surtout de Picabia, Chirico s’imprégna des théories de Nietzsche sur l’inspiration et sur l’éternel retour, il sembla trouver un intérêt particulier dans la lecture d’Ecce homo…
Que cela soit à travers ses nombreuses copies des grands maîtres (Raphaël, Titien, Rubens, Watteau, Courbet…) ou par le biais des remakes, la répétition apparaît comme une donnée majeure. Places, tours, arcades, cheminées, poètes et troubadours… sont tellement ressassés dans la peinture métaphysique qu’ils sont devenus des « lieux communs » de notre musée imaginaire. Est-ce seulement pour lutter contre l’angoisse, en faisant du passé une « valeur refuge » (5) ? Chirico a souvent peint et sculpté la statue d’Ariane endormie, délaissée par son amant Thésée. Ariane et Dionysos (son consolateur), c’est aussi la mesure contre la démesure, l’ordre des choses contre le chaos. D’une part, la répétition fige le flux et impose un ordre : les thèmes de la statue, du cheval ou celui des Bains mystérieux (qui apparaît en 1934 pour illustrer les Mythologies de Jean Cocteau) furent ruminés jusqu’à sa mort. D’autre part, la répétition engendre le chaos : en perpétuel aller-retour avec lui-même, Chirico fit des remakes de ses tableaux métaphysiques tout au long de sa vie (au départ sur commande). Les ajouts, les substitutions, et les changements de formats et de titres peuvent être comparés aux variations musicales autour d’un thème. Mais le farouche individualiste, qui savait que les amateurs ne juraient que par les œuvres de sa jeunesse, sema la zizanie dans le marché en antidatant ces remakes !
Aujourd’hui, il serait tentant de faire de Chirico le pionnier du courant « appropriationniste » et des ressassements qui touchent autant la peinture que les champs de l’installation et du design. Pourtant son approche de l’art n’avait rien en commun avec les répliques un peu vaines d’un Mike Bidlo ou la sérialisation qu’Andy Warhol fit subir aux Muses inquiétantes (6). Et puis, la copie, l’interprétation et la réitération d’un modèle ne sont-elles pas des traditions fortement ancrées dans les pratiques humaines ? Une chose est sûre : les artistes « cannibales » du XX° siècle (Picasso, Picabia, Dali, Chirico…) n’ont pas attendu l’invention de la post-modernité pour se livrer aux jeux savants du détournement des sources…
(1) Giorgio de Chirico a notamment dénoncé les manœuvres d’André Breton pour faire main basse sur le marché des peintures métaphysiques, cf. Mémoires, La Table ronde, Paris, 1965, p. 140-141. A ce propos, voir l’excellent article de Gérard Audinet, « Le lion et le renard », dans Giorgio de Chirico, la fabrique des rêves, Paris Musées, 2009, p.111-120.
(2) Francis Picabia, Écrits critiques, préface de Bernard Noël, édition établie par Carole Boulbès, Paris, Éditions Mémoire du livre, 2005.
(3) cf. Michael Taylor, « Variations sur une énigme : les « dernières » œuvres de Giorgio de Chirico et Philip Guston », Giorgio de Chirico, la fabrique des rêves, p. 257.
(4) Caroline Thompson, « L’énigme de la régression chez Giorgio de Chirico », Giorgio de Chirico, la fabrique des rêves, op. cit., p. 203.
(5) Caroline Thompson, ibidem.
(6) cf. Warhol verso de Chirico, a cura di Achille Bonita Oliva, Comune di Roma, Milano, Electa, 1982. Warhol admirait Chirico qu’il avait rencontré en 1972. Pour cette exposition qui comportait des dessins et des sérigraphies, il s’est inspiré de remakes que l’Italien avait réalisés entre 1950 et 1962. Dans son entretien avec Oliva, il déclara : « J’aime son travail et l’idée qu’il a répété les mêmes peintures encore et encore ». Bien sûr, l’intraitable Chirico, qui avait notamment intenté un procès aux organisateurs de la Biennale de Venise de 1948 pour avoir exposé un faux, ne put réagir à ces détournements pop qu’il aurait sûrement jugé vulgaires : il était décédé depuis quatre ans…
Comment Chirico est-il perçu par les artistes aujourd’hui ? Quels liens établissent-ils avec leurs œuvres ? Dans le catalogue de l’exposition Giorgio de Chirico, la fabrique des rêves au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, on ne dispose que de quatre témoignages. C’est peu. Publiés récemment par le même musée, Raoul Dufy, le plaisir en livrait sept ; Francis Picabia, singulier idéal quatorze. De nos jours, les artistes hésitent encore (est-ce une question de génération ?) à remettre en question le clivage entre le « bon » Chirico de la Metafisica et le « mauvais » qui vint ensuite. Pour Télémaque, l’Italien s’est égaré sous l’influence du peintre Nicola Locoff. Au contraire, Bernard Dufour pense qu’il fait partie des « héros » qui sont « allés au bout d’eux-mêmes » et Konrad Klapheck ose avouer, contre ses amis surréalistes, que certains tableaux du « Chirico tardif » l’ont profondément touché. Seul Giulio Paolini revendique l’influence du « maître » à qui il rend hommage avec son Intérieur métaphysique présenté à la galerie Yvon Lambert.
Pourquoi une œuvre d’art ou une période donnée sont-ils reconnus et appréciés, alors que l’autre est bannie ? Chirico a dénoncé les « combines » des critiques et des marchands qui rejetaient ses nouvelles peintures. Ses règlements de compte haineux (1) peuvent être rapprochés de certains écrits journalistiques de Francis Picabia (2). Plus tard Philip Guston (3), un autre rebelle, fut l’un des rares artistes à défendre l’ensemble du travail de Chirico et à revendiquer son influence. Chirico est mort à l’âge de 90 ans, en 1978, il a donc traversé le vingtième siècle en continuant à peindre malgré l’acrimonie des surréalistes qui lui reprochaient son retour aux références classiques.
A cet égard, est-il convaincant de distinguer « trois catégories : la peinture métaphysique, le retour à la peinture traditionnelle, la reprise de la peinture métaphysique »(4)? Une telle vision fait l’impasse sur les phénomènes cycliques de retours qui travaillent quasiment chacune des peintures. Chirico, l’élu, le voyant est aussi l’artiste de la rumination. Rumination désabusée d’un idéal antique. Rumination des peintures fin de siècle d’Arnold Böcklin et de celles, foncièrement novatrices des primitifs italiens. En 1928, le maître qui rédige son « Petit traité technique de peinture » est aussi, paradoxalement, le provocateur qui met en scène des meubles monumentaux occultant le paysage, ou encore des gladiateurs débiles, des anti-héros ridiculement grands pour les intérieurs où ils livrent bataille. Tout en poursuivant son idéal technique (retrouver le métier des Anciens) et en fulminant contre l’art moderne, Chirico a réalisé une galerie d’autoportraits parodiques qui sont des attaques contre la figure et le rôle même du peintre : en notable de la Renaissance, en gentilhomme costumé, en vieille homme revêche assis nu sur une chaise, et même en torero farouche ! Or, dans sa jeunesse, à l’instar de Duchamp et surtout de Picabia, Chirico s’imprégna des théories de Nietzsche sur l’inspiration et sur l’éternel retour, il sembla trouver un intérêt particulier dans la lecture d’Ecce homo…
Que cela soit à travers ses nombreuses copies des grands maîtres (Raphaël, Titien, Rubens, Watteau, Courbet…) ou par le biais des remakes, la répétition apparaît comme une donnée majeure. Places, tours, arcades, cheminées, poètes et troubadours… sont tellement ressassés dans la peinture métaphysique qu’ils sont devenus des « lieux communs » de notre musée imaginaire. Est-ce seulement pour lutter contre l’angoisse, en faisant du passé une « valeur refuge » (5) ? Chirico a souvent peint et sculpté la statue d’Ariane endormie, délaissée par son amant Thésée. Ariane et Dionysos (son consolateur), c’est aussi la mesure contre la démesure, l’ordre des choses contre le chaos. D’une part, la répétition fige le flux et impose un ordre : les thèmes de la statue, du cheval ou celui des Bains mystérieux (qui apparaît en 1934 pour illustrer les Mythologies de Jean Cocteau) furent ruminés jusqu’à sa mort. D’autre part, la répétition engendre le chaos : en perpétuel aller-retour avec lui-même, Chirico fit des remakes de ses tableaux métaphysiques tout au long de sa vie (au départ sur commande). Les ajouts, les substitutions, et les changements de formats et de titres peuvent être comparés aux variations musicales autour d’un thème. Mais le farouche individualiste, qui savait que les amateurs ne juraient que par les œuvres de sa jeunesse, sema la zizanie dans le marché en antidatant ces remakes !
Aujourd’hui, il serait tentant de faire de Chirico le pionnier du courant « appropriationniste » et des ressassements qui touchent autant la peinture que les champs de l’installation et du design. Pourtant son approche de l’art n’avait rien en commun avec les répliques un peu vaines d’un Mike Bidlo ou la sérialisation qu’Andy Warhol fit subir aux Muses inquiétantes (6). Et puis, la copie, l’interprétation et la réitération d’un modèle ne sont-elles pas des traditions fortement ancrées dans les pratiques humaines ? Une chose est sûre : les artistes « cannibales » du XX° siècle (Picasso, Picabia, Dali, Chirico…) n’ont pas attendu l’invention de la post-modernité pour se livrer aux jeux savants du détournement des sources…
(1) Giorgio de Chirico a notamment dénoncé les manœuvres d’André Breton pour faire main basse sur le marché des peintures métaphysiques, cf. Mémoires, La Table ronde, Paris, 1965, p. 140-141. A ce propos, voir l’excellent article de Gérard Audinet, « Le lion et le renard », dans Giorgio de Chirico, la fabrique des rêves, Paris Musées, 2009, p.111-120.
(2) Francis Picabia, Écrits critiques, préface de Bernard Noël, édition établie par Carole Boulbès, Paris, Éditions Mémoire du livre, 2005.
(3) cf. Michael Taylor, « Variations sur une énigme : les « dernières » œuvres de Giorgio de Chirico et Philip Guston », Giorgio de Chirico, la fabrique des rêves, p. 257.
(4) Caroline Thompson, « L’énigme de la régression chez Giorgio de Chirico », Giorgio de Chirico, la fabrique des rêves, op. cit., p. 203.
(5) Caroline Thompson, ibidem.
(6) cf. Warhol verso de Chirico, a cura di Achille Bonita Oliva, Comune di Roma, Milano, Electa, 1982. Warhol admirait Chirico qu’il avait rencontré en 1972. Pour cette exposition qui comportait des dessins et des sérigraphies, il s’est inspiré de remakes que l’Italien avait réalisés entre 1950 et 1962. Dans son entretien avec Oliva, il déclara : « J’aime son travail et l’idée qu’il a répété les mêmes peintures encore et encore ». Bien sûr, l’intraitable Chirico, qui avait notamment intenté un procès aux organisateurs de la Biennale de Venise de 1948 pour avoir exposé un faux, ne put réagir à ces détournements pop qu’il aurait sûrement jugé vulgaires : il était décédé depuis quatre ans…
dimanche 15 mars 2009
voyage à syracuse

Dans la dernière semaine de décembre 1999, tandis que les rumeurs de bug informatique envahissaient Paris, un jeune professeur de français, Charles Ornan, décida de passer quelques jours dans la ville de Nancy pour mener une recherche à la Bibliothèque Stanislas, grâce à une lettre de recommandation de Madame Gloria Cerpe. Dès le premier jour, il explora le fonds encyclopédique et spécialisé, à la recherche d’inédits. La bibliothèque comportait plus de 30000 ouvrages et devait fêter son 250e anniversaire en 2000. Il savait qu’il lui serait impossible de tout lire. Il savait qu’en une vie de chercheur, il aurait tout juste le temps de feuilleter négligemment 20 ouvrages par jour pendant les 35 semaines ouvrables des 41 années de sa mission publique, soit 31.500 livres. Jetant son dévolu sur le fonds Buvard, Ornan tomba sur un mince cahier intitulé Le Voyage à Syracuse -par un certain F.P.- qui lui était absolument inconnu et dont certaines pages étaient couvertes de signes kabbalistiques inscrits dans les marges. À d’autres endroits, des groupes entiers de pages étaient cornés...
La suite sur publie.net
http://www.publie.net/tnc/spip.php?article217
dimanche 22 février 2009
wim delvoye

Wim Delvoye, Esquisse préparatoire pour D11, 2007
"Monter/démonter, Wim Delvoye et l’art des cathédrale", publié dans L’Art de l’assemblage. Relectures. Actes du colloque organisé à l’INHA le 28 et 29 mars 2008, sous la direction de Stéphanie Jamet-Chavigny et Françoise Levaillant, Presses universitaires de Rennes, janvier 2011, p. 203-211.
Wim Delvoye a ceci de particulier qu’il agace par ses images fortes mais répétitives, qu’il irrite par ses constructions insolites mais parfaites. Il est de ceux qui prennent le contre-pied de l’avant-garde, tout en revendiquant l’héritage de Marcel Duchamp, Man Ray, Francis Picabia, Andy Warhol et…Léonard de Vinci. Non sans humour, il annonçait récemment la venue du « super artiste ». Qu’est-ce à dire ? Il s’en est expliqué lors d’une interview (1) pour la Fondation Musée Grand-duc Jean, au Luxembourg : Le super artiste a la capacité « de pouvoir s’organiser seul pour s’affranchir de toute contrainte et ne pas être tributaire du circuit artistique ». Après le règne des critiques d’art, après le règne des commissaires d’exposition, voici venu celui du super-artiste ! Rapportée aux déclarations sur l’« impuissance » (2) de l’art belge et ses propres « efforts pour n’arriver à rien » (3) qui datent respectivement de 1995 et 2005, cette annonce a de quoi surprendre. L’artiste aurait-il perdu de sa modestie, ou s’agit-il d’un des pièges conceptuels qu’il aime nous tendre ?
On pourrait dire de Wim Delvoye qu’il est le roi de l’assemblage (« action de fixer ensemble des éléments pour former un tout, un objet ») et du montage d’idée parfaitement ajusté. Bien qu’il se réfère à Warhol et au modèle de l’artiste entrepreneur plus qu’aux collages et objets de Claes Oldenburg, une certaine parenté peut être mise en avant. Avec ses bâtons de rouge à lèvres géants qui faisaient office de sculptures monumentales sur la place de Piccadilly (Lipsticks in Piccadilly Circus, 1966), Oldenburg procédait au rapprochement de deux réalités éloignées. Il créait une image impossible, un assemblage loufoque. Le choc perceptif résultait du surdimensionnement. La rupture d’échelle induisait aussi le « débordement » au sens psychologique, érotique et physique du terme. Trois années plus tard, l’érection de la sculpture Lipstick (ascending) on caterpillar tracks sur le campus de l’Université de Yale, en pleine contestation de la guerre du Vietnam, ne fit pas l’unanimité : l’assemblage de ce tube de rouge à lèvre de sept mètres de haut sur un engin chenillé de cinq mètres de long était un acte de provocation antimilitariste assumé (4). En combinant d’un côté symbole phallique, machinisme militariste, et de l’autre, maquillage féminin, l’objet se voulait aussi dérisoire que menaçant. En 2007, le D11 de Wim Delvoye permet de saisir certaines contiguïtés et de pointer des différences. Cette vue en perspective d’un modèle réduit de bulldozer pourrait être comparée à l’élévation d’Oldenburg pour son Lipstick géant. Le bulldozer est une cathédrale gothique. La cathédrale gothique est un bulldozer. C’est une image forte et incongrue qui repose aussi sur le rapprochement de deux réalités éloignées (machine et palais épiscopal, mouvement et immobilité, matière et spiritualité). Comme on le sait, il s’agit d’un principe surréaliste qui fut théorisé par André Breton dans son Manifeste de 1924, en réaction à un article de Paul Reverdy sur L’Image (5). Une fois acquis ce principe de rapprochement et de transfert de sens, on surprend Wim Delvoye à filer la métaphore : Cement truck (2003) est un modèle réduit de camion à bétonnière dont la hauteur (moins d’un mètre) est pulvérisée par Dump truck (2006) qui a les proportions d’un camion réel, à l’instar du Caterpillar de bois et métal, qui, comble d’ironie, fut exposé en 2001 dans une église gothique ! Delvoye est finalement moins intéressé par l’agrandissement et le surdimensionnement, technique pop que l’on rencontre également dans les peintures de Tom Wesselmann, que par la confection d’ assemblages métalliques qui viennent se substituer aux vrais objets, à l’échelle 1.
Il en va de même pour les modèles réduits de cathédrales gothiques de la série Chapel dont Delvoye est en quelque sorte le maître d’œuvre puisque leur réalisation (en tout point impeccable) est confiée à des artisans spécialisés. Ces ouvrages, à propos desquels l’artiste me disait s’être intéressé à la Sainte-Chapelle de Paris ainsi qu’aux vitraux de la cathédrale de Chartres, ressemblent à de la dentelle gothique en inox ! L’aspect industriel, la brillance et le côté flambant neuf sont, bien sûr, aux antipodes des vieilles pierres du gothique flamboyant. Les vitraux de ces maquettes, eux aussi, ne manquent pas de surprendre par le caractère brutaliste de leur imagerie obtenue aux rayons X : leur unique sujet est le corps de l’homme et du cochon : intestin, copulation, zoophilie pour l’essentiel. Accentuant toujours plus ce télescopage mental entre le visible et l’invisible, Delvoye a transformé une aile de la Fondation Musée Grand duc Jean au Luxembourg en environnement gothique, où le visiteur entre et circule à sa guise. Le fort décalage que génère cet assemblage d’inox et de verre au cœur de l’architecture moderne de Ieoh Ming Pei, n’est pas le moindre des paradoxes. L’œuvre ne peut laisser indifférent, elle force la réflexion sur le corps et l’âme, la pureté et l’impureté, la religion et l’abjection. Elle amène à réfléchir, avec Pierre Sterckz, sur le fait que « l’art qui survit aujourd’hui à l’effondrement du christianisme s’est muséalement sanctifié comme une religion laïque » (6). D’ailleurs, ne parle-t-on pas communément des chapelles de l’art contemporain ? Malgré les déflagrations conceptuelles qu’il provoque et les références possibles à Antonin Artaud, Georges Bataille ou Francis Picabia passés maîtres dans l’art de l’irrévérence et de la provocation iconoclaste, la dimension contestataire n’est pourtant pas la visée première de Delvoye. Son œuvre ne délivre pas de message politique (7). Il s’agit pour lui de défier les collectionneurs, l’art et le système, tout en créant ce qu’il appelle « une économie symbolique parallèle » (8) qui révèle et exacerbe les contradictions du marché de l’art. L’aboutissement le plus délirant de ce mode de pensée est l’introduction en bourse de sa Société Cloaca (qui produit des machines à merdes) dont l’une des réalisations fut présentée à Düsseldorf en 2002, avec à l’arrière-plan les douze vitraux de la série Chapel. Pour beaucoup de critiques ou d’amateurs éclairés, un seuil fut franchi lors de cette exposition inconvenante, qui fut pourtant précédée par la création de céramiques décoratives à motifs d’étrons.
On pourrait parler d’une mise en abyme du divin et du maudit, de la consécration et de la souillure. Les productions de la Cloaqua sont intouchables, les vitraux qui devraient introduire du spirituel, ne cachent que souillure et impureté. Wim Delvoye pointe ce que Roger Caillois avait nommé « l’ambiguïté du sacré » (9) : ce sont « les mêmes interdits qui préservent de la souillure, isolent la sainteté et protègent de son contact ». C’est à la fois pur et impur, attirant et repoussant.
La création d’images efficaces et photogéniques comme une bonne affiche, l’intérêt pour le décoratif et un certaine attirance pour le « bien fait » (même lorsqu’il s’agit d’étrons) constituent des motivations essentielles pour Delvoye qui revendique le statut d’ « artiste visuel » (10). Il n’est pas sans importance qu’il se qualifie de « faiseur d’images », de créateur d’objets qui deviennent des « icônes » (11) et non de collagiste, d’assembleur ou de sculpteur. Mixer l’image d’« objets démocratiques, plébéiens, prolétariens » (12) avec d’autres images empruntées à l’histoire de l’art occidental, cela revient à renvoyer, comme au jeu de « ping pong » (13), les dichotomies entre le bon et le mauvais goût, entre la culture populaire et la « haute culture ». La notion d’ « émulsion » (14) revendiquée par l’artiste dit bien ce qui est en question : les codes en présence ne se mélangent pas, ils co-existent en créant ce que Pierre Sterckz appelle un « troisième terme » ni clair, ni obscur car « tout y est lisible et visible, mais rien ne s’y soumet au sens traditionnel des usagers des signes et des choses » (15). Ce troisième terme, peut être observé dans Saint-Stéphanus I en 1990. Que voit-on ? Un vitrail représentant un prélat en habit, qui s’inscrit dans une construction en ogive, avec ses arcs brisés caractéristiques du style gothique. Dans un deuxième temps, on remarque la profondeur de l’objet et le damier rouge sur la structure en acier qui évoque une cage de gardien de but. Le prélat -qui fait penser aux moines que l’on voit sur certaines bières d’abbaye belges- est un gardien de but dans une cage (de handball) en verre. Sa mission sacrée, qui suscite un véritable culte et même l’ idolâtrie du public (pensons à l’équipe de footballeurs de Saint-Étienne), consiste à empêcher le ballon d’entrer !
En s’extrayant de la logique binaire, Wim Delvoye nous donne à voir « deux images en même temps » (16), un peu comme Man Ray avec son Cadeau de 1921 (un fer à repasser hérissé de clous) ou René Magritte avec Les vacances de Hegel (une peinture représentant un verre rempli d’eau posé au sommet d’un parapluie ouvert). Il s’agit bien de créer des courts-circuits par assemblage de concepts, en se jouant de la dialectique hégélienne (thèse-antithèse-synthèse).
Lors de notre récent entretien, Wim Delvoye revendiquait l’héritage de Picabia, Duchamp, Man Ray et Manzoni, mais pas celui de Magritte. Oubli ? omission ? imprégnation plutôt, comme on le comprend à travers cette déclaration faite à Geneviève Breerette en 2005 : « Dans la culture belge, j’aime bien le coté surréaliste. Il fait partie du paysage. Si on vit ici, on en est imprégné et on n’a pas besoin d’avoir Magritte comme vrai papa » (17). Pierre Sterckz, quant à lui, souligne « la nature duelle des travaux de Delvoye, qu’ils soient kitsch, scatologiques ou magrittiens ». Dans sa récente publication sur Le surréalisme en Belgique (18), Xavier Cannone consacre sa conclusion aux artistes « héritiers de Magritte » et évoque « l’ironie en coup de poing » de Delvoye. Le Magritte insolite qui peignait Les vacances de Hegel, et avant cela Le montagnard, pendant la période troublée et scabreuse des expérimentations « vache » est donc forcément présent à l’esprit de Delvoye, qui, comme Marcel Broodthaers « est belge, se trouve de par sa culture métissée, aux carrefours de la littérature et des medias, là où des zones d’indiscernabilité font surgir l’animalité, entre chien et loup, entre culture d’élite et culture populaire. » (19)
C’est certain, l’animalité, « le devenir cochon » mais aussi une certaine fascination pour Walt Disney ne doivent pas être négligés lorsqu’on parle de Wim Delvoye. Obsédé par l’imagerie populaire et religieuse, l’artiste tatoue des Christs en croix, mais aussi des Cendrillon ou des Mickey sur la peau des porcs qu’il élève dans sa ferme en Chine. Le mélange des deux thématiques a produit, en 2000, un très iconoclaste dessin de Crucifixion que je serais tentée de rapprocher de la Femme en croix de Picabia en 1925, qui représente une Espagnole presque nue, l’un des thèmes érotiques et folkloriques favoris de l’artiste. De la même façon, les grands esprits sacrilèges se rencontrant, on peut établir une corrélation avec un collage plutôt caustique de Claes Oldenburg en 1966 : Drainpipe/crucifix, où le Christ en souffrance est crucifié sur un tuyau d’écoulement ! Il s’agit d’un avant-projet pour une autre proposition monumentale de l’artiste américain qui aurait dû prendre corps à Coronation Park, à Toronto, mais qui, cela va sans dire, ne fut jamais réalisé, même dans sa version expurgée ! Tout cela n’est pas sans évoquer les sculptures récentes de Wim Delvoye où le corps du Christ s’enroule à l’intérieur ou à l’extérieur de la croix. Malgré leur charge explosive, qu’il ne faudrait pas, selon Pierre Sterckz, assimiler à des profanations : « Mettre Jésus en boucle topologique, c’est tenter de le représenter comme à la fois corps pur et âme pure. C’est montrer un Christ qui advient et revient selon toutes les dimensions du temps(…) ». Filant la métaphore, Sterckz évoque même un drôle de Christ-Möbius : « C’est la croix enfin incarnée en son éternel retour, la croix devenue résurrection logique. Ou encore, le Christ débarrassé du mythe du progrès humain dont on avait chargé ses épaules et redevenu la force primitive cyclique qu’il détenait » (20). De là à parler de figuration de l’éternel retour nietzschéen, il n’y avait qu’un pas que l’historien franchit également ! Pourtant, si on s’attache strictement à décrypter ce que le « faiseur d’images » nous donne à voir, on peut arriver à une toute autre conclusion : les distorsions que Wim Delvoye inflige au Christ, qui s’enroule comme un tortillon effilé ou comme un gâteau d’apéritif autour d’une croix elle-même spiralée, les déformations monstrueuses des jambes et des bras particulièrement dans Ring Jesus inside, tout cela ne plaide pas en faveur d’un art respectueux de la religion catholique ! D’ailleurs, si l’on compare Ring Jesus outside avec les anneaux qui existent vraiment dans la bijouterie religieuse, force est de constater que l’agrandissement du corps du Christ, sorte de géant coincé dans un ridicule petit anneau, est encore à l’origine du choc visuel. À nouveau, le jeu d’échelle est essentiel, qui transforme ces bagues en œuvres monumentales. Que ces « icônes » soient en même temps iconoclastes au sens premier de « briseur d’images » (eikonoklastês), cela ne fait pas de doute ; qu’elles soient nietzschéennes semble beaucoup plus incertain, et ce, d’autant que l’artiste n’évoque pas cette source philosophique pour ces travaux, contrairement, par exemple, à Thomas Hirschhorn.
Faudrait-il, pour conclure, se livrer à des considérations générales sur les « représentations typiques de la conscience contemporaine d’aujourd’hui, désespoir de la condition humaine, qui se replie sur une interrogation constante et répétée du corps, de son enveloppe et de son contenu » (21). Faudrait-il verser le cas Delvoye au crédit de la thèse accablante de Catherine Grenier dans les dernières pages de Dépression et subversion (22) :
« Au début du XX° siècle, la mort de Dieu a pour vis-à-vis la menace pesant sur la perpétuation de l’art lui-même. La dépression s’offre alors comme le modèle d’une assomption de la fin de l’art, un art placé dans la perspective eschatologique d’un dépassement de sa propre fin. Un dépassement qui s’appellera transgression, subversion, radicalité, ces termes qui émaillent toute l’histoire et la pensée des avant-gardes. »
Je préfère penser, avec Roger Caillois, qu’il existe une polarité du sacré où s’opposent le pur et l’impur, le respectable et l’abject. Comme l’ont montré par exemple Hugo Ball au Cabaret Voltaire et Picabia à la galerie Léonce Rosenberg, sacré et profane sont imbriqués dans la création artistique. Dans les assemblages et démontages conceptuels de Delvoye, avant-garde et anti-art, spiritualité et bas matérialisme, forces vives de destruction et de création sont constamment mêlées, sans que l’on puisse jamais limiter l’art à l’expression du désespoir, de l’impuissance, de la dépression ou de la mort.
(1) Isabelle de Baets et Hendrik Tratsaert , « L’hygiène du message et le virus de la forme ou de l’art en tant qu’instrument de lutte sociale chez Wim Delvoye », interview avec Wim Delvoye, Almanach, Luxembourg, Musée d’art moderne Grand Duc Jean, 2004, p. 147-149.
(2) « Wim Delvoye, Entretien avec Nestor Perkal », Wim Delvoye, Craft, Musée départemental de Rochechouart, 1995, p. 28.
(3) Wim Delvoye, « Je cherche à donner une cotation à l’art », propos recueillis par Geneviève Breerette, Le Monde, 26 août 2005.
(4) Barbara Rose, Claes Oldenburg, New York, MOMA, 1970, p. 108-114.
(5) André Breton citait le début de l’article de Paul Reverdy sur « L’image » paru dans Nord-Sud n°13, en mars 1918 : « L’image
Elle ne peut naître d’une comparaison mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées.
Plus les rapports des deux réalités rapprochés seront lointains et juste, plus l’image sera forte –plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique. »
(6) Pierre Sterckz, Le devenir cochon de Wim Delvoye, Bruxelles, La lettre volée, 2006, p. 79.
(7) « Mon travail n’a pas changé et je ne veux pas changer mon travail. Parce que j’ai toujours eu cette modestie ethnique et je n’ai jamais eu un message politique. Les gens se demandent encore : « Il est contre ou il est pour ? ». Ils ne le savent pas. Par exemple : le football c’est vraiment célébrer les masses ? On ne comprend pas si je critique ou pas, si je suis pour ou contre.», voir « Wim Delvoye, Entretien avec Nestor Perkal », op. cit., p. 29. Voir aussi la réponse à Geneviève Breerette qui demandait à l’artiste s’il cherchait à « démonter les mécanismes du capitalisme » : « Oui, oui, montrer le système. Je ne suis pas vraiment contre, c’est plutôt ironique. Je me moque. Je suis sans parti pris. Je suis belge, je suis flamand. Je n’ai rien à gagner à prendre part. Je n’ai pas d’opinion. »
(8) Isabelle de Baets et Hendrik Tratsaert , « L’hygiène du message et le virus de la forme ou de l’art en tant qu’instrument de lutte sociale chez Wim Delvoye », op. cit. p. 147-149.
(9) Roger Caillois, L’homme et le sacré, (1° édition, 1939), Paris, Gallimard, 1950,
p. 79.
(10) Wim Delvoye, « Je cherche à donner une cotation à l’art », op. cit.
(11) « Wim Delvoye, Entretien avec Nestor Perkal », op. cit., p. 26.
(12) Wim Delvoye, « Je cherche à donner une cotation à l’art », op. cit.
(13) « Wim Delvoye, Entretien avec Nestor Perkal », op. cit., p. 29.
(14) D’après le Petit Robert, « mélange hétérogène de deux liquides non miscibles », terme évoqué par Wim Delvoye dès le début de son « Entretien avec Nestor Perkal », op. cit., p. 23.
(15) Pierre Sterckz, Le devenir cochon de Wim Delvoye, op. cit., p. 51.
(16) Pierre Sterckz, Le devenir cochon de Wim Delvoye, op. cit., p. 18.
(17) Wim Delvoye, « Je cherche à donner une cotation à l’art », op. cit.
(18) Xavier Canonne, Le surréalisme en Belgique, Actes Sud, 2007, p. 314.
(19) Pierre Sterckz, Le devenir cochon de Wim Delvoye, op. cit., p. 37.
(20) Pierre Sterckz, Le devenir cochon de Wim Delvoye, op. cit., p. 124-125.
(21) Jean-Hubert Martin, « Au laboratoire du corps », Scatalogue, Musée d’art contemporain de Lyon, 2003, p.9.
(22) Catherine Grenier, Dépression et subversion, les racines de l’avant-garde, Paris, Éditions du Centre Pompidou, p. 128-129.
samedi 21 février 2009
surréaliste et merveilleux

"Surréaliste et merveilleux jusqu'à un certain point...". Publié dans le catalogue de l'exposition L'homme merveilleux, Château de Malbrouck, Manderen, mars 2008.
"Le merveilleux est toujours beau, il n’y a même que le merveilleux qui soit beau". André Breton
Voilà, semble-t-il, une vérité qui ne se discute pas : le merveilleux est beau. Et pourtant ! Quelle est cette bonne blague qui sonne comme une péroraison ou un aphorisme asséné à coup de marteau ? Quel tour facétieux André Breton et Paul Eluard nous ont-ils joué en inscrivant cette définition dans leur Dictionnaire abrégé du surréalisme en 1938 ? Après tout, le merveilleux est-il toujours beau ? Et si cette affirmation était avérée, le laid rimerait-il forcément avec l’horrible ? Plus de quatre-vingt ans après la publication du premier Manifeste du surréalisme, qu’en est-il du merveilleux aujourd’hui ?
MANNEQUIN ET RUINES
La force d’une telle assertion s’explique à la lecture des premières pages du Manifeste de 1924 : il y est question de « faire justice de la haine du merveilleux qui sévit chez certains hommes, de ce ridicule sous lequel ils veulent le faire tomber ». Ainsi, André Breton entendait-il brandir l’étendard du merveilleux contre le goût dominant de son époque. Il en faisait une arme de guerre pour imposer la « surréalité », « réalité absolue » où le rêve et la réalité ne sont plus des états contradictoires. Entre les mains des surréalistes, le merveilleux n’était plus un concept suranné ni puéril, mais une « révélation » :
« Le merveilleux n’est pas le même à toutes les époques ; il participe obscurément d’une sorte de révélation générale dont le détail seul nous parvient : ce sont les ruines romantiques, le mannequin moderne ou tout autre symbole propre à remuer la sensibilité humaine durant un temps. » (1)
Le merveilleux est un stimulant, une secousse émotive qui nous sort de nous-mêmes pour nous laisser entrevoir un monde plus vaste, un monde onirique qui nous était caché. Le merveilleux émane de deux symboles foncièrement idéalistes et non dénués de mélancolie, qui expriment fortement l’intérêt de Breton pour l’art du passé : les ruines et le mannequin. Les ruines, expression de la nostalgie d’un âge d’or à jamais perdu, vision du sublime plus que du merveilleux, ce pourrait être celles des dessins de Piranèse, des peintures d’Hubert Robert, de Pierre Henri de Valenciennes ou des aquarelles de Caspar David Friedrich. Les mannequins, ce pourrait être les êtres désarticulés qui envahissent les collages de Max Ernst, les peintures de Giorgio de Chirico ou de Carlo Carrà. Ils font penser aux marionnettes du monde romantique allemand qui, selon Bernhild Boie (2), trouvent un prolongement dans les poupées d’Hans Bellmer. De toute évidence, un souffle romantique anime ce dangereux “partage du sensible” auquel les surréalistes nous convient.
MASQUES ET MAROTTES
L’automate, l’épouvantail, le mannequin sont indissociables du thème du double. Lorsqu’elle revêt des masques et se travestit en idole païenne ou en poupée à message (3), unique sujet de ses autoportraits photographiques, Claude Cahun, nièce de l’écrivain Marcel Schwob, exprime cette profonde ambiguïté. Mélancolie, dédoublement et processus de fragmentation romantique de la personnalité à travers différents rôles vont de paire avec la fascination pour l’homme vide, dans les ruines. Le trouble naît d’une perte et même d’un deuil : la ruine n’est plus que le vestige imparfait du passé ; le mannequin n’est qu’une enveloppe vide à l’allure plus ou moins philosophique, à l’image des personnages qui hantent les peintures métaphysiques. Giorgio de Chirico est sans doute le peintre qui a le mieux exprimé cette vacance de l’être. Son Grand métaphysicien domine la place d’une ville désertée, mais ce n’est qu’une statue antique anachronique juchée sur un promontoire bancal. Tout aussi vides, Les masques de 1917 dissimulent des mannequins creux, dédoublés, claustrés dans une salle remplie d’équerres : ce ne sont que des parodies d’humains. On sait, de l’aveu même du peintre, que l’impact de la philosophie allemande sur son approche du « non-sens » ne fut pas négligeable : « L’art a été libéré par les philosophes modernes et par les poètes […] Ce furent Schopenhauer et Nietzsche qui enseignèrent les premiers quelle profonde signification a le non-sens de la vie. Il enseignèrent aussi comment ce non-sens pouvait être traduit en art. » (4) L’univers poétique de Giorgio de Chirico -qui fascina tant les surréalistes- est un monde délaissé par Dieu et par l’homme lui-même. « Le vide effrayant qu’on découvre est d’une beauté comparable à celle calme et inanimée de la matière », écrivait-il (5).
ÉROS ET THANATOS
Pour réhabiliter le merveilleux, Breton évoquait aussi, dans son Manifeste, le plaisir extrême que procure l’univers des contes de fée et notamment la lecture de Peau d’âne. Ces symboles sont animés d’une double force étrangement contradictoire. Comme la belle et la bête de Peau d’âne, le mannequin et la poupée expriment une tension, un tiraillement entre grotesque et mélancolie, entre Éros et Thanatos, entre les forces dionysiaques et apolliniennes (6).
Dans la peinture de Francis Picabia, autre fervent lecteur de Nietzsche (7), le masque de carnaval caricature les traits des personnages en faisant saillir un nez pointu, en exagérant une moue. Le masque, c’est aussi le déguisement dont se pare la mort. Malmenant le thème moraliste de la Vanité, Picabia a repeint son Portrait d’un docteur qui représentait initialement un homme chauve, vêtu d’une chemise blanche, pointant de son index un crâne de mort. Dans la version retouchée, le visage a disparu sous un masque, la tête a été coiffée d’un bonnet de fou rose et bleu et recouverte de différents signes organiques ou kabbalistiques ! Dès 1927, Picabia s’était fait connaître des amateurs surréalistes en créant d’autres bouffonneries dionysiaques : des Monstres furieusement enlacés et visiblement peu gênés par leurs contours démultipliés et leurs longs nez de carnaval, des êtres albinos mouchetés, des femmes aguichantes pourvues d’ailes de bombyx du mûrier, de machaon et autres papillons diurnes et nocturnes…
BURLESQUE ET MAUVAIS GOÛT
Ce balancement entre comique et tragique, cette tension au cœur du merveilleux sont exprimés dans le Manifeste de 1924 : « Dans ces cadres qui nous font sourire, pourtant se peint toujours l’irrémédiable inquiétude humaine. » (8) Pour développer cette idée, André Breton cite la littérature fantastique et s’approprie la légende de La Nonne sanglante qui inspira notamment Mathew Gregory Lewis et Charles Nodier. Tout en revendiquant l’intrigue de ce roman noir, Breton lance une nouvelle provocation : « Dans le mauvais goût de mon époque, je m’efforce d’aller plus loin qu’aucun autre. » De quoi s’agit-il ? Il imagine posséder un château (La nonne sanglante est un spectre qui hante un château) où « l’esprit de démoralisation » aurait élu domicile, en même temps que certains de ses amis (Aragon, Soupault, Eluard) et… quelques jolies femmes ! La quête amoureuse poussée jusqu’aux limites de la folie et du macabre, a toujours été un leitmotiv surréaliste. Après tout, Nadja était le récit de la rencontre romanesque de Breton avec une femme d’exception, mais c’était aussi l’histoire d’un internement. De même, on ne regarde plus les dessins érotiques d’Hans Bellmer de la même façon lorsque l’on a lu Sombre printemps, la poignante autobiographie d’Unica Zürn, sa compagne et modèle... À travers les figurations de Roberte, Pierre Klossowski a mis en scène les fantasmes inhérents à ces jeux de traques pervers, aux allures sacrificielles. Avec l’humour et la distance qui le caractérisait, Man Ray (qui fut l’auteur de véritables films et photos pornographiques) a su donner une interprétation à la fois moderne et burlesque de cette parabole romantique. Son film Les mystères du Château de dé tourné en 1929 dans la propriété des Noailles à Hyères montre, au terme d’un périple automobile, l’architecture cubiste de Robert Mallet-Stevens, et les facéties de deux couples cagoulés qui se livrent frénétiquement à différentes activités… sportives (gymnastique et natation) dans ce haut lieu du modernisme. Commanditaires du film, le vicomte et la vicomtesse de Noailles pourraient bien se dissimuler derrière les masques du couple qui interroge d’énormes dés pour décider de son avenir, et qui, pour finir, se transforme en statue ! Bien que les Noailles n’y aient vu aucune malice, ces visages effacés derrière leur mince protection de tissu font penser aux Amants que René Magritte peignit en 1928. Ils donnent une vision assez édulcorée du couple hétérosexuel et de l’amour ! À une époque où le culte du beau corps bien fait prenait son essor, ce film dissimulait, sous son caractère bon enfant, une profonde satire des mœurs hygiénistes.
La même année, Picabia rédigea le scénario amoral de La Loi d’accommodation chez les borgnes où il revendiquait le triomphe de la « folie furieuse », dénuée de « but ». La Loi est l'histoire d'un crime commis par un cul-de-jatte : il assassine un milliardaire américain qui s'apprêtait à offrir une rivière de diamants à une jeune manucure, puis il produit un faux témoignage qui mène à la condamnation à mort d’un peintre et d’un policier, également épris de la jeune femme. En définitive, le malfaiteur, disgracieux, menteur et criminel, triomphe de ses rivaux, s’enrichit et épouse l’héroïne ! Dans ce projet, les célibataires étaient réversibles comme des cartes à jouer. Le scénario était axé sur les rivalités masculines, le sport, l’argent et la religion. Les incessants changements d’identité –que les surréalistes avaient appréciés naguère dans les divers épisodes de Fantômas- devaient être facilités par les truquages cinématographiques, avec une loufoquerie proche des créations de Georges Méliès et du cinéma burlesque.
Survenant quelques mois avant Un chien andalou, le projet de Picabia fut éclipsé par le scandale que provoqua la projection parisienne du film de Bunuel et Dali, dont les époux Noailles étaient les commanditaires et les mécènes. Le mauvais goût que Breton appelait de ses voeux (celui qui provoque le rejet et la censure) était le moteur de passages sulfureux tels que celui de la superposition de l’œil incisé au rasoir et du cliché romantique de la lune ou des deux ecclésiastiques accrochés à deux pianos ensanglantés... Le film de Bunuel et Dali dépassait indéniablement le stade du « permis » pour se heurter au « défendu » (9)… En flirtant avec le territoire interdit des désirs les plus secrets, le film fascina André Breton sans doute aussi parce qu’il exprimait la violence du désir physique masculin, désir incarné à l’écran par Pierre Batcheff qui se suicida le dernier jour du tournage (10)… Aux yeux de Breton, le cinéma, « seul mystère absolument moderne » valait pour son « pouvoir de dépaysement » ; « la merveille » résidait dans le fait de s’abstraire de sa propre vie et de se laisser glisser dans la fiction (11).
POÈMES-OBJETS
Avec les objets aussi, le surréaliste partait à la conquête du “point critique” qui unissait la veille au sommeil. En proposant, dès 1924, la fabrication et la mise en circulation d’objets apparus en rêve, Breton cherchait toujours à atteindre ce fameux point de l’esprit où l’imagination est reine. Alors que Ducasse et Rimbaud avaient provoqué un « bouleversement total de la sensibilité : mise en déroute de toutes les habitudes rationnelles, éclipse du bien et du mal, réserves expresses sur le cogito, découverte du merveilleux quotidien » (12), les « poèmes-objets » de Breton et les objets de Giacometti, Max Ernst, Valentine Hugo, Dali… répondaient à la nécessité de fonder une véritable « physique de la poésie » (13). En 1923 déjà, Man Ray anticipait cette requête en créant De quoi écrire un poème, collage sur un carton ondulé de différents papiers, d’une ficelle et d’une plume d’oie placés dans un cadre de bois. L’inspiration n’était plus à chercher au-delà de l’homme, mais dans le quotidien, ici et maintenant, comme ces « poèmes-conversations » que Guillaume Apollinaire traquait dans le bus ou dans les cafés, comme ces bribes de journaux que Tzara préconisait de découper pour composer au hasard un poème dadaïste. En 1924, la conception surréaliste de la poésie reposait toujours sur le collage et l’assemblage, elle n’était pas foncièrement éloignée de ces prémisses cubistes et dadaïstes :
« Les papiers collés de Braque et Picasso ont même valeur que l’introduction d’un lieu commun dans un développement littéraire du style le plus châtié. Il est même permis d’intituler POÈME ce qu’on obtient par l’assemblage aussi gratuit que possible (…) de titres et de fragments de titres découpés dans les journaux. » (14)
Pour Breton, l’image surréaliste « la plus forte est celle qui présente le degré d’arbitraire le plus élevé. » (15) Le merveilleux est donc à la portée de celui qui accepte l’apparente gratuité et même l’aspect risible de certaines analogies : « Dans la forêt incendiée, les lions étaient frais » (Roger Vitrac). Il apparaît à l’esprit qui accepte d’être déconcerté. Traquer le merveilleux, c’est aller au-delà de la contradiction. Cette chasse déconcertante trouve son terreau dans un horizon d’attente plus ou moins mystique (rue Fontaine, les surréalistes faisaient tourner les tables ; plus tard Breton a laissé entendre que les recherches surréalistes étaient proches des recherches alchimiques), étayé par des méthodes qui avaient pour but de « forcer l’inspiration » (16) : collage, assemblage, frottage, grattage, décalcomanie, rayogramme, cadavre exquis... Le merveilleux apparaît à qui sait l’attendre, mais il peut aussi être convoqué par celui qui croit à la possibilité d’une « dictée de la pensée en dehors de tout contrôle exercé par la raison », d’un « automatisme psychique pur » (17).
COURTS-CIRCUITS ET MYTHOLOGIE NOUVELLE
Provoquer un choc qui soit de nature à déconcerter l’esprit était une visée essentielle. Il fallait reproduire ce « moment idéal où l’homme, en proie à une émotion particulière, est soudain empoigné par « plus fort que lui. » » (18) La reproduction photographique d’un œil féminin en relief placée sur le métronome de l’Indestructible (1923-1959) de Man Ray exprime bien ce « dérèglement de tous les sens » (Rimbaud) qui résulte de la rencontre de deux réalités éloignées. Miner le « sens commun » et traquer la « bête folle de l’usage » (19), tels sont les deux mots d’ordre dont Le Loup-table de Victor Brauner (1939-1947) et Le déjeuner en fourrure (1936) de Meret Oppenheim donnent de très probantes illustrations. À la lisière du merveilleux et du fantastique, de l’érotisme noir de Georges Bataille et des peintures inconvenantes de Clovis Trouille, ces objets produisent un effet répulsif qui n’est pas foncièrement éloigné des images littéraires de la Nonne sanglante ou de Peau d’âne.
Il s’agit bien de mettre en œuvre un cabinet de curiosité moderne qui favorisera le dépaysement et le choc des rencontres. C’est pourquoi la Fontaine de Duchamp (1917) ou son énigmatique French window (1921) peuvent, rétrospectivement, trouver une place dans le panthéon surréaliste (20). C’est pourquoi les productions des aliénés, les objets trouvés, les poupées kachinas, les statuettes africaines et océaniennes, peuvent côtoyer les peintures de Picabia ou celles de Miro dans le bureau de travail d’André Breton. Aragon a d’ailleurs dit l’état hallucinatoire qui résultait de la quête et du déploiement d’un tel univers :
« C’était au temps que nous réunissant le soir comme des chasseurs, nous faisions notre tableau de la journée, le compte des bêtes que nous avions inventées, des plantes fantastiques, des images abattues (…) Tout se passait comme si l’esprit parvenu à cette charnière de l’inconscient avait perdu le pouvoir de reconnaître où il versait. En lui subsistaient des images qui prenaient corps, elle devenaient matière de réalité. » (21)
Les surréalistes sont des collectionneurs invétérés qui traquent le merveilleux au coin d’une rue ou sur les étalages du marché aux Puces. Développant, avant les situationnistes, toute une poétique de l’errance, ils vivent la « mythologie en marche » (22) et partent « en quête de ces objets qu’on ne trouve nulle part ailleurs, démodés, fragmentés, inutilisables, presque incompréhensibles, pervers » (23). Guidé par sa croyance aveugle au principe du hasard objectif, Breton s’extasie sur l’une de ses trouvailles : une étrange cuiller en bois dotée d’un soulier qu’il imagine « manipulée par Cendrillon avant sa métamorphose. » (24) Cet objet doit être appréhendé sous le signe du déplacement, alors que d’autres joueront sur la condensation, autre grand ressort dynamique que Freud mit au cœur du travail du rêve. Ce flirt avec la psychanalyse trouve un développement dans la méthode paranoïa-critique de Dali ou dans sa théorie des « objets à fonctionnement symbolique », « basés sur les phantasmes et représentations susceptibles d’être provoqués par la réalisation d’actes inconscients » (25). De tels objets, assure Dali, « ne dépendent que de l’imagination amoureuse de chacun ». Une montre molle, une chaussure à fonctionnement scatologique ou un Taxi pluvieux qui abrite un mannequin déshabillé couvert de vrais escargots, suggèrent des « perversions, et par conséquents des faits poétiques » (26).
On le conçoit aisément, le merveilleux surréaliste a partie liée avec l’érotisme, le laid et l’horrible, le plaisir et la souffrance tout autant qu’avec le beau. Ce n’est que l’avers et le revers d’une même notion. Le merveilleux se tient à la jonction de ces oppositions et lorgne vers « le point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement. » (27) L’ambition est de créer un nouveau mythe, ou plutôt, d’observer le développement de cette « mythologie moderne » qui apparut à Breton lorsqu’il fut confronté aux œuvres métaphysiques de Giorgio de Chirico. Dans Le Paysan de Paris, Louis Aragon se questionne sur l’émergence de cette « mythologie » qui est consubstantielle au « sentiment du merveilleux quotidien » ; il s’interroge sur la logique qui structure nos modes de pensée et sur la peur de l’erreur qui nous fait préférer la raison à l’imagination. En pleine crise de la société bourgeoise, on pense à l’appel des romantiques allemands Hölderlin, Schelling, Friedrich Schlegel… à une mythologie nouvelle (28). On pense aux critiques de la raison auxquelles se livrait Nietzsche, et à sa méfiance vis-à-vis du langage. « Transformer le monde » a dit Marx, « transformer la vie a dit Rimbaud » : pour les surréalistes ces deux mots d’ordre » n’en faisaient qu’un.
L’INSALUBRE MERVEILLEUX
Martelé par André Breton à la fin de Nadja, le principe selon lequel « la beauté sera CONVULSIVE ou ne sera pas » ne peut être dissocié de cet « air particulièrement insalubre » (29) qu’il apprécia dans la poésie de Rimbaud et de Baudelaire, l’esthète du « beau dans l’horrible ». Cette composante est essentielle pour l’élaboration des objets de terreur que furent la Poupée bicéphale de Bellmer ou Le festin des Cannibales lors de l’exposition surréaliste internationale de 1959. Que de telles œuvres appartiennent à une histoire littéraire dont l’image de la femme (et de l’homme) ne sorte pas vraiment grandie, Cindy Sherman l’a bien compris, elle qui réalisa, en 1996, la série des Horror and surrealists pictures à partir de masques grotesques, à la lisière du morbide.
Dès lors, trois caractères bien différents apparaissent, qui permettent de spécifier ce qui se dégage aujourd’hui du merveilleux surréaliste, comme révolte contre l’ordre établi, comme volonté de créer un nouveau mythe moderne (et romantique).
Première orientation : le burlesque et les changements de rôles. Quelques soixante-dix ans après La loi d’accommodation chez les borgnes, et bien que ses obsessions ne soient pas l’Amour ni la mise à nu de la promise par ses célibataires mêmes, les saynètes comiques de Pierrick Sorin confronté à son double Jean-Loup (1994) ou jouant tous les personnages féminins et masculins dans Nantes, projets d’artistes (2001) font penser aux frasques des anti-héros de Picabia. Proliférant, saturé d’autoportraits peu flatteurs, l’univers cru de Pierrick Sorin est à la fois répulsif et attirant.
Deuxième orientation : le grotesque et la fantaisie résultant de recherches d’équivalences ou d’analogies. Une telle approche caractérise tout aussi bien les œuvres de Dali et Magritte que les peintures récentes de John Currin. Bien que l’artiste américain ne revendique guère une telle filiation (30), l’allure dérangeante de sa Morroccan (2001), femme entre deux âges dont la tête blonde et le teint blafard sont garnis de trois gros poissons grisâtres, n’est pas sans rappeler les associations insolites auxquelles se livraient les peintres et les créateurs d’objets surréalistes. Toutefois les distorsions que Currin impose à la figure humaine (surtout aux femmes !) ne vont pas aussi loin que le Stropiat de Magritte avec ses trois nez à carreaux et ses multiples pipes !
Enfin, l’autre voie que Wim Delvoye est l’un des rares artistes à arpenter, en réglant ses pas sur ceux des grands sacrilèges dadas et surréalistes, est celle de l’inconvenance et l’incorrection. Inconvenance de Cinderella (Cendrillon), un porc tatoué et empaillé dans la ferme de l’artiste. Incorrection de ses détournements de l’art gothique, avec ses cathédrales miniatures en inox, ses pelleteuses et bétonnières en bois sculpté. En réunissant des réalités contradictoires (bas matérialisme et spiritualité aurait dit Georges Bataille, bon et mauvais goût aurait dit Picabia), Delvoye inscrit son travail dans une histoire des créations irrévérencieuses qui passe par Marcel Duchamp, Man Ray, Francis Picabia, Piero Manzoni et Marcel Broodthaers.
(1) André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924, réédition Gallimard, Pléiade, tome 1,1988, p. 321.
(2) Bernhild Boie, L’homme et ses simulacres, essai sur le romantisme allemand, José Corti, 1979.
(3) En 1927, Claude Cahun s’est photographiée, le visage décoré de petits cœurs, vêtue d’un justaucorps blanc où était écrit : “I’am in training, don’t kiss me” (“Je suis à l’entraînement, ne m’embrassez pas”).
(4) Cité par Wieland Schmied, “L’art métaphysique de Giorgio de Chirico et la philosophie allemande : Schopenhauer, Nietzsche, Weininger”, catalogue de l’exposition Giorgio de Chirico, éditions du Centre Georges Pompidou, 1983, p. 97.
(5) Ibidem, p. 100.
(6) Voir à ce propos les mannequins féminins détournés par les surréalistes lors de l’exposition de la galerie des Beaux-Arts à Paris, en 1938.
(7) Voir notre texte, “Francis Picabia, monstres délicieux, la peinture, la critique, l'histoire”, dans le catalogue Cher Peintre…Lieber Maler… Dear Painter… : peintures figuratives depuis l'ultime Picabia, Paris, éditions du Centre Georges Pompidou ; Vienne, Kunsthalle Wien ; Francfort : Schim Kunsthalle Frankfurt, 2002, p.29-32.
(8) André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924, op. cit., p. 321.
(9) André Breton, “Comme dans un bois”, L’âge du cinéma, numéro spécial surréaliste, août-novembre 1951, n°4-5, p. 26-30.
(10) Voir Cinéma dadaïste et surréaliste, éditions du Centre Georges Pompidou, 1976, p. 24. Ainsi que l’a expliqué Philippe Soupault, auteur de l’Invitation au suicide, cette idée hantait les surréalistes. Après la disparition de Jacques Vaché, le premier numéro de La Révolution surréaliste (décembre 1924) posait la question : « Le suicide est-il une solution ? ». Jacques Rigaut s’est suicidé en 1929, René Crevel en 1935.
(11) Ibidem.
(12) André Breton, “Crise de l’objet”, 1936, publié dans Le surréalisme et la peinture, Gallimard, 1965, p. 275-280.
(13) Expression de Paul Eluard, citée par André Breton dans “Crise de l’objet”, op. cit., p. 279.
(14) André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924, op.cit., p. 341.
(15) André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924, op.cit., p. 338.
(16) Voir Max Ernst, “Comment on force l’inspiration”, Le Surréalisme au service de la Révolution, n° 6, 15 mai 1933.
(17) André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924, op. cit., p. 328.
(18) André Breton, Second manifeste du surréalisme, 1930, réédition Gallimard, Pléiade,1988, p. 809.
(19) André Breton, “Crise de l’objet”, op. cit.
(20) Voir André Breton, “Phare de la mariée”, Minotaure n° 6, 1935.
(21) Louis Aragon, Une vague de rêves, Livre Club Diderot, tome 2, 1921-1925, p. 233-234.
(22) Louis Aragon, Le paysan de Paris, 1925, réédition Gallimard, 1975, p. 141.
(23) André Breton, Nadja, 1928, réédition Gallimard, Pléiade, tome 1, 1988, p. 753.
(24) André Breton, L’amour fou, 1937, réédition Gallimard, folio, 1977, p. 49.
(25) Salvador Dali, “Objets surréalistes”, Le surréalisme au service de la révolution, n°3, p. 16-17.
(26) Ibidem
(27) André Breton, Second manifeste du surréalisme, 1930, réédition Gallimard, Pléiade, tome 1, 1988, p. 781.
(28) Voir Rita Bischof, “Les romantiques allemands et l’impossible mythe de la modernité”, Europe n° 900, Le romantisme révolutionnaire, avril 2004, p. 22-39. Rappelons aussi la phrase de Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy dans L’absolu littéraire, théorie de la littérature du romantisme allemand, éditions du Seuil, Paris, 1978, p. 25 : « Il y a aujourd’hui dans la plupart des grands motifs de notre « modernité », un véritable inconscient romantique ».
(29) André Breton, Second manifeste du surréalisme, 1930, op.cit., p. 802.
(30) John Currin semble plus proche de la peinture allemande de Cranach, Hans Baldung Grien et Martin Kippenberger, voir son interview dans le catalogue de l’exposition Cher Peintre, op. cit., p.74-78.
périls en la demeure

"Périls en la demeure, l'irruption de la maison dans le musée d'art contemporain". Publié dans le catalogue de l'exposition Le Paris des Maisons, Objets trouvés, coédition Picard et Pavillon de l'Arsenal, Paris, mars 2004.
Depuis une dizaine d'années, on remarque une forte croissance des démarches artistiques axées sur une approche critique du design (Alain Bublex, Martin Boyce, Atelier Van Lieshout, Bless…), sur une parodie ou un détournement des valeurs de l'artiste entrepreneur (Fabrice Hybert, Liam Gillick, Tobias Rehberger…) ou collectionneur (Collection Joon Ja et Paul Devautour, Swetlana Heger et Plamen Dejanov…).
L'une des conséquences de cet art "orienté objets" est que l'espace de la maison (fictif ou réel) est de plus en plus souvent transféré dans le musée, le centre d'art, la galerie. Au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Genève, la collection Joon Ja et Paul Devautour était présentée dans les pièces d'un appartement reconstitué. A Cologne, Joep Van Lieshout exposait sa Hausfreund I comportant lit, évier, baignoire, éléments de cuisine, le tout plus ou moins cloisonné, inutilisable et éclaté dans l'espace du Kölnischer Kunstverein. Dans certaines installations Tobias Rehberger propose des arrangements domestiques qui ne sont pas sans évoquer les salles d'exposition des magasins de meubles, elles suggèrent l'idée d'espace privé, cool et confortable comme "à la maison"…
On pourrait parler d'un étrange jeu de vases communicants, d'une mutation saugrenue des fonctions. La maison intime, la maison refuge fait irruption dans le musée. Parallèlement, n'importe quelle habitation privée (même une minuscule chambre de bonne) peut être transformée en galerie que le public est convié à visiter. L'opposition entre privé et public semble inopérante. La sphère de l'intime est réifiée dans la valeur d'exposition. A cet égard, la récurrence des chambres à coucher (1) installées dans le musée, le centre d'art, la galerie peut être considérée comme un symptôme. Qu'il soit espace de repos, d'ébats sexuels (Mc Carthy, Jota Castro) ou de surveillance (Julia Scher), le lit est par excellence synonyme d'intimité. Sa présence incongrue dans les lieux d'exposition souligne à quel point les limites et les frontières sont devenues poreuses. Au fond, on pourrait dire que le processus de déplacement et de transgression artistique n'a guère changé depuis Etant donnés de Marcel Duchamp : mise en scène intimiste, installation d'objets plus ou moins rectifiés, plus ou moins symboliques, sexy ou trash. En revanche, la volonté de faire glisser le spectateur de l'état de voyeur à celui d'acteur semble de plus en plus prépondérante. La participation active du visiteur est même devenue une procédure convenue, au point que l'on pourrait parler d'une expérience domestique du musée, lieu de pseudo convivialité où l'on est convié à écouter de la musique, à regarder un film en mangeant du pop corn, où il s'agit d' habiter l'exposition (2) tout en gardant bien sa place, tout en respectant bien le dispositif. L'avant-garde qui, selon Thomas Crow, "englobait des styles et des tactiques de provocations extra-artistiques, un mode de vie fondé sur le groupe clos et la survie sociale" (3) ne peut exister dans un tel système (4). Pourtant, le désir transgressif des artistes perdure sans que l'on sache jusqu'à quel point il est instrumentalisé par l'institution elle-même. En 1980, Roland Barthes avait épinglé l'ambiguïté de cette attitude artistique sous l'étiquette de "complexe de Clovis" : "brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé" (5). Il s'agit de rompre avec la perception ordonnée et institutionnalisée du musée, tout en s'y inscrivant pleinement. Dès lors les permutations de signes au cœur du paradigme de la maison semblent illimitées et les mutations de plus en plus inquiétantes : fantasme de l'œuvre d'art d'être habitée, de se transformer en cellule, fantasme de tuer son prochain et de détruire l'espace domestique, maison spectacle, habitat distopique, changement d'échelles et de nature… La maison-musée ressemble à une déviance quelque peu inquiétante que l'on aurait mise sous quarantaine.
LE FANTASME DE L'ŒUVRE D'ART DE SE TRANSFORMER EN ORGANE VIVANT OU EN CELLULE
Placer des grottes ou des cabines d'isolement dans les espaces institutionnels d'exposition n'est pas le moindre des paradoxes. Après les Demeures d' Etienne-Martin, la Tour aux figures et le Jardin d'hiver de Jean Dubuffet, Louise Bourgeois a développé et illustré le concept de Cellules pendant les années 90. Cellule de prison, cellule d'habitation. L'ambiguïté du terme est grande. Avec Choisy I (1990-1993), le sculpteur met plutôt en place un environnement carcéral. Elle expose une maquette architecturale blanche qui évoque la mémoire des lieux où elle a vécu et travaillé pendant son enfance. Celle-ci est placée au centre d'une prison partiellement grillagée et vitrée, surmontée du couperet d'une guillotine. Ce dispositif peut être lu comme la traduction de son angoisse face à l'irruption de l'étranger dans la maison (l'"Unheimlichkeit" freudienne), mais il s'explique également par la volonté de construire un espace autonome, qui nierait en quelque sorte celui du musée :
"Je voulais créer ma propre architecture et ne pas dépendre de l'espace du musée pour adapter son échelle à celui-ci. Je souhaitais qu'elle constitue un espace réel où l'on pourrait entrer et dans lequel on pourrait marcher. Je n'aimais pas que l'art dépende des beaux espaces où il était simplement posé. Je ne voulais pas de ce monde fermé." (6)
Dès le début des années 50, Louise Bourgeois s'est intéressée à l'espace de la sculpture dans le musée. Par la suite, des artistes tels que Robert Morris et Robert Smithson ont formulé les idées de "non-architecture"et de "non-site".
Le rejet de l'espace traditionnel d'exposition (caractéristique du Land art, du Body art pendant les années 1960) ou l'acceptation de cette contrainte pour la création de travaux "in situ" qui s'appuient sur l'architecture (comme ceux de Daniel Buren par exemple) ou sur le caractère social des lieux (Rikrit Tiravanija, Tobias Rehberger…), constituent deux pôles créatifs que l'on pourrait distinguer en adoptant le vocable d'"environnement construit" pour le premier et d' "installation" pour le second. ils induisent deux rapports très différents à l'espace du musée, du centre d'art ou de la galerie.
ENVIRONNEMENT CONSTRUIT
Construction homogène
Demeure
Entité autonome préexistante au lieu
Non contextuel
INSTALLATION
Installation hétérogène
Dispositif
Accumulation
Agencement
Ensemble créé in situ, réglé en fonction du lieu
Contextuel
Le Merzbau de Kurt Schwitters, La maison de Jean-Pierre Raynaud étaient-ils plutôt des installations ou des environnements construits ? Avec Schwitters, l'irruption de la sculpture dans la maison avait quelque chose d'endémique. Pendant vingt ans, le Merzbau en bois, plâtre et carton se développa tel un organisme vivant "de la cave jusqu'à l'étage supérieur, sortant d'une fenêtre pour entrer dans une autre" (Raoul Hausmann). Cette "sculpture abstraite (cubiste)" (7) regroupant de multiples objets à l'intérieur de casiers et de petites chambres destinés aux amis, envahit progressivement sa propriété d' Hanovre jusqu'au bombardement allié qui la détruisit en 1943. Après-guerre, Schwitters aurait souhaité retourner à Hanovre pour relever le Merzbau de ses ruines. Au lieu de cela, il resta en Angleterre et créa une autre installation, le Merzbarn dans la grange de son jardin, près d' Ambleside (8).
A l'opposé, la maison de Raynaud à la Celle-Saint-Cloud formait un bloc homogène aux allures très militaires (un blockhaus), avec ses surfaces recouvertes de carrelage blanc aux jointures noires, ses portes blindées, sa meurtrière et ses barbelés. Même si elle évolua au cours de ses vingt-trois années d'existence (9), il s'agissait moins d'une "installation" vivante qui proliférerait au fil des rencontres ou des interventions que d'un "environnement construit" ultra protecteur et ultra menaçant. Cette "crypte" surmontée d'un "mirador" (10) trahissait à la fois sa hantise de la mort (11) et sa peur de l'altérité.
Le Merzbau sort du mur et se propage comme une expérience excentrique. L'habitation de Raynaud invite au repli et à l'intériorisation. Corollaire du cabinet de curiosités ou de la collection qui dévore l'espace vital, la maison-musée a fréquemment une valeur indicielle. Elle est le signe de la crise identitaire du sujet : autiste ou connexionniste, vide ou remplie d'objets, la maison-musée est presque toujours non fonctionnelle et peut se lire comme un portrait (12).
DÉSIR DE TUER, DECONSTRUCTIONS DU MODÈLE DOMESTIQUE
Non sans ironie, l'icône enfantine de la maison à toit pointu a été exploitée par de multiples créateurs, de Louise Bourgeois à Nathalie Elemento. De leur côté, Sylvie Fanchon, David Tremlett ou Hugues Reip ont constitué des répertoires de formes usuelles de façades ou de plans au sol, pour en souligner la pauvreté.
Mais à quel moment la maison et le foyer sont-ils devenus sources d'interrogation pour les artistes? Quand l'espace domestique est-il devenu un objet de détournement ? Dans une optique benjamienne axée sur l'idée de choc médiatique (13), il est tentant de penser que cet intérêt ironique fut suscité par les catalogues de décoration et les magazines où furent imprimées les premières réclames photographiques en couleur. Très tôt, les reproductions d'intérieurs modernes mis en valeur par la publicité ont fait l'objet de critiques acerbes. Dès 1956, Richard Hamilton réalisait son célèbre collage annonciateur du Pop art (14) : Just what is it that makes today's homes so different, so appealing ? où la télévision, les comics et les marques faisaient irruption dans le salon d'un couple moderne fort soucieux de sa beauté corporelle.
Par la suite, les catalogues de constructeurs de lotissements de pavillons individuels ont été fréquemment la cible des artistes (Taroop et Glabel, Christophe Vigouroux…). En 1966, Dan Graham initiait cette attitude en photographiant des lotissements de banlieue, destinés à être intégrés dans un article d'Arts Magazine rédigé par lui-même (Homes for America) (15).
La maison des années soixante, comme icône du bonheur et reliquat d'une foi inébranlable dans le progrès et les bienfaits de l'urbanisme, est également mise à mal par la collection de Boring Postcards de Martin Parr. Qu'ils s'agissent de résidences préfabriquées ou de camps de vacances bien ordonnés, les photographes (16) s'efforçaient de mettre en scène une sorte d'état de bonheur permanent. Avec le recul, ces icônes paraissent aussi désuètes que les réclames, aussi manipulatrices que les peintures de propagande politique.
A la fin des années soixante, lors de la guerre du Vietnam, des artistes se sont attaqués violemment aux modes de vie que génère un tel endoctrinement par l'image de catalogue ou de presse. En 1968, dans les célèbres Intérieurs américains du peintre Erro, l'ordre domestique était menacé par des rebelles Vietcongs prêts à assiéger les maisons de rêve des magazines américains. Plus radicaux, les photomontages de Martha Rosler de la série Bringing the War Home : House beautiful (1967-1972) introduisaient des images de G.I au cœur de cuisines modernes bien aménagées. Rosler s'est expliquée sur son état d'esprit au moment où elle insérait également des photos de victimes vietnamiennes dans le cadre précieux du salon de Lady Nixon :
"Je voulais reconstituer une image du monde que les documents photographiques ne cessaient de couper en deux : d'une part les photographies de cette jungle lointaine en proie à la pauvreté ; de l'autre, les images plus riches de notre vie dominée par des idéaux domestiques, d'un optimisme inébranlable" (17).
Dans ses photos et ses films (comme Semiotics of the kitchen, 1975), Rosler s'est attaquée au rôle de la belle ménagère dotée de l'électroménager dernier cri. Dans cette optique, la maison modèle n'est rien d'autre que le sanctuaire d'une situation infantile intériorisée, où chaque femme doit tenir son rôle.
Cette méfiance face au conditionnement social qui résulte des belles maisons avec leurs belles cuisines "équipées", cette ironie face au progrès de la domotique, sont sensibles dans les œuvres de Rosemarie Trockel où elle tranforme des plaques électriques de cuisson en motifs décoratifs. Il transparaît dans les installations monumentales de Jessica Stockholder qui intègrent différents appareils d'électroménager qui chauffent, lavent, réfrigèrent…le vide. Plus extrême encore, Mona Hatoun électrifie les meubles et les ustensiles de cuisine qu'elle présente derrière les grillages d'une prison. Symboliquement, Homebound (2000) exprime une menace de mort et un désir de tuer. Pour l'artiste, il s'agit de traduire un sentiment féminin qu'elle estime fort répandu : un mélange d'attraction et de répulsion envers le foyer.
Pourtant Le Cadeau de Man Ray (un fer à repasser hérissé de clous) ne serait pas du tout déplacé dans cet espace d'enfermement et de terreur. Il serait d'ailleurs commode mais inexact de penser que cette violence symbolique ne concerne que les femmes ou les féministes. Dès les années 1960, Claes Oldenburg, par exemple, créait un monde hallucinatoire peuplé de simulacres de mobiliers (tel que le Bedroom ensemble), d'objets familiers mous (téléphone, lavabo, grille-pain…), de nourritures en plâtre peint. Mais l'action la plus agressive fut sans nul doute celle que Gordon Matta-Clark infligea à une maison en bois du New Jersey, en 1974 : il n'hésita pas à la couper entièrement en deux dans l'axe vertical puis il modifia l'assise pour faire pencher l'une des deux parties. En équilibre "entre le sol et le ciel" (18), traversée par la lumière, la maison fut également débarrassée de quatre des ses coins. Des fragments de façades issus d'un autre travail de découpe baptisé Bingo furent exposés en Allemagne au Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte de Münster, la même année.
Postérieures mais toutes aussi extrêmes, certaines sculptures d'Oppenheim questionnent et mettent en danger la maison, en tant qu'espace symbolique. Monument to escape présente une habitation placée en apesanteur et littéralement explosée en trois blocs instables qui menacent de s'écrouler sur les jeunes mariés qui sont placés devant elle. Dans cette maquette faite en hommage aux victimes du terrorisme d'état en Argentine, la maison est perçue comme un container prêt à l'emploi, où les pires exactions sont possibles. C'est une maison de correction, une prison où l'on torture, où l'on tue. Avec Device to Root out Evil (1997), l'artiste s'attaque à un autre type de symbole, celui de l'hospitalité que l'on trouve dans toutes les "bonnes maisons". Il choisit la forme bien reconnaissable d'une église qu'il présente de façon peu amène : retournée et enfoncée dans le sol par la pointe de son clocher, la maison du Bon Dieu n'accueille plus aucun "fidèle". Oppenheim interroge les thématiques chrétiennes de la protection, de la gratification et de la vertu. Il rejette la logique de la croyance et renverse l'ordre établi. La maison ne protège plus. Elle tue. Elle n'est plus synonyme d'extériorité de façade ni d'intériorité refuge, mais simplement un décor instable qui menace de liquider ses occupants.
D'autres projets ont pris la forme de dessins, de maquettes ou de constructions monumentales qui se situent à la lisière de la sculpture et de l'architecture. Jump and twist (1999) réunit des cabines transparentes qui sautent, twistent et traversent les murs du musée en défiant la pesanteur. Avec Image intervention (1984), Oppenheim invente une maison non fonctionnelle ("imagined house") qui se déploie de façon anarchique à partir d'une image mentale. Ces formes libres en métal, béton et bois annonçaient les folies déconstructivistes de Coop Himmelblau ou de Bernard Tschumi.
Détruire, construire. L'antinomie est aussi vivace qu'au temps des avant-gardes historiques. Construction et déconstruction, enchantement et désenchantement constituent les pivots de la maison dans le musée.
LA MAISON PAR DELÀ LE SPECTACLE
Selon Marie-Ange Brayer, "seule la maison réunirait le singulier et générique, le moi et son entourage, le cadre et le déplacement, le parodique et l'héroïque" (19). A cet égard, l'engouement pour les demeures qui ont abrité des personnalités est un phénomène particulièrement intéressant. Sur la façade de l'habitation parisienne de Gainsbourg, les graffitis témoignent de l'impact du "funclubbing". La maison de star n'appartient plus tout à fait au monde tangible, elle se transmue en sanctuaire mythique, une sorte d'écrin du souvenir que l'on vénère comme un monument, comme une châsse contenant des reliques. La maison-totem du héros disparu devient le point de ralliement des consommateurs de spectacles et de légendes.
La maison pour Joséphine Baker (1995) de Dennis Adams pose justement le problème de la relation entre l'architecture, l'image publique de la star et le voyeurisme. L'œuvre est réalisée à partir d'une reproduction de la maquette qu'Adolf Loos créa pour la vedette, en 1928. L'artiste détourne le projet ultra-moderne de Loos qui consistait à installer -sur deux étages- une grande piscine intérieure en verre, entourée de salles de réception également vitrées. Court-circuitant l'idée de ballet aquatique aux accents érotiques, Adams décide de placer la maquette de ce projet culte -jamais construit- dans un aquarium rempli d'eau (20) !
Dans le même esprit, Alexandre Perigot s'est intéressé à la maison de la chanteuse Dalida qui fait partie du circuit touristique du quartier Montmartrois. Cette fois le constat est désenchanté : à part la plaque commémorative, rien ne laisse supposer qu'il s'agit de la maison d'une star. Perigot s'attache les services d'un spécialiste des décors de cinéma et confectionne une reproduction en deux dimensions de la maison vue en perspective à l'échelle 1:1. Monumentale, La Maison témoin mesure treize mètres par onze. Comme ces façades classées que l'on maintient avec des étais afin de construire un nouveau bâtiment derrière, elle ne cache rien d'autre que du vide. Ce travail sur la tromperie des apparences et les ravages de l'industrie du spectacle s'est poursuivi récemment à la cinquantième Biennale d'art contemporain de Venise où l'artiste avait installé -à l'attention des amateurs de tourisme culturel- une immense bâche qui occultait les deux faces d'un immeuble près du canal. Radio Popeye montrait les vraies maisons d'un faux village de pêcheurs -en fait le décor d'un film de Robert Altman pour les studios Disney- abandonné en Europe, sur l'île de Malte.
Cette critique de l'industrie du cinéma à travers ses décors de maisons vides constitue également l'une des orientations du travail de Dennis Oppenheim dans Stage set for a film (1998). De façon encore plus virulente, un autre américain, Paul Mc Carthy expose des décors de série T.V ou de film (La maison de Pinocchio, 1994, Painter, 1995, Saloon, 1996…). Certaines de ces installations comportent des personnages qui caricaturent les figures héroïques, enfantines ou érotiques de l'industrie du spectacle, d'autres ont été le cadre de performances qui surpassent en dérision et en outrance les productions de la télévision poubelle.
DISTOPIE
Aux antipodes de la maison autiste ou connexionniste, déconstructiviste ou désenchantée, il existe aussi des démarches artistiques qui flirtent avec l'utopie et la réalité, en envisageant d'autres façons de se loger ou d'aborder la ville.
Comme la mode, l'utopie architecturale naît souvent d'une relecture des créations du passé. Tandis que le familistère de Godin à Guise semble laisser les artistes de marbre, les formes circulaires ou organiques de La maison des gardes agricoles de Claude-Nicolas Ledoux (1780), La Maison du souvenir d'Hermann Finsterlin (vers 1915), La Space House (1933) de Frederick Kiesler, La Walking city (1964) et Le Living-Pod gonflable (1965) d'Archigram… générent des fantasmes futuristes dont les traces les plus évidentes se perçoivent dans le regain d'intérêt pour le design d'Olivier Mourgue pour 2001, L'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick…
Présenté à Orléans dans le cadre de l'exposition Archilab (21), le projet de maison ovoïde de l'architecte mexicain Fernando Romero pour l'artiste Gabriel Orozco s'inscrit tout à fait dans cette veine. S'il ne s'agissait d'un détournement de La maison Farnsworth de Mies Van der Rohe, on pourrait penser avoir affaire à une maquette de Frederick Kiesler !
Ainsi que l'écrit Franco Borsi, l'utopie au vingtième siècle, "siècle de l'isolement, de l'autarcie versus la communication et le libre-échange…" s'est transformée "en distopie, en antithèse d'elle-même en anti-utopie"(22). Ce pessimisme teinté d'espoir est très présent dans le film Bubble House (1999) de Tacita Dean, où l'artiste découvre par hasard, aux Caraïbes, une maison qui ressemble à un énorme OVNI blanc de forme ovale, abandonné sur la plage.
Cet engouement pour les créations utopiques du passé (par exemple les machines volantes de Léonard de Vinci) est central dans les œuvres de Panamarenko. Il transparaît également dans le "revival" de La Futuro, maison mobile en polyester, posée sur des pieds de métal et dont la forme évoque une soucoupe volante. Dessinée en 1968 par l'architecte finlandais Matti Suuronen, elle fut redécouverte grâce à Carsten Höller qui l'intégra dans son installation Skop à la Wiener Secession de Vienne en 1996. L'exposition était éclairée par l'énergie solaire (23) et la Futuro placée au centre du dispositif devait évoquer, non sans ironie, une promesse de bonheur dans un monde où l'homme réconcilié avec la nature, se déplacerait en vélo ou en voiture électrique.
D'autres artistes réfléchissent de façon plus rationnelle mais toute aussi distopique à ce que pourrait être la maison du futur. Lors de sa dernière exposition parisienne, Andréa Blum proposait d'acheter une Nomadic house constituée de structures mobiles qui peuvent être adaptées n'importe où, à condition de disposer d'un espace d'au moins 4 m2. Plutôt froids et austères, ces modules combinables (lit, penderie, table, étagères) répondent aux problèmes de la mobilité et du manque d'espace perçus comme des menaces qui pèsent sur le futur de nos sociétés technocratiques. De la même façon, les projets Rational House, Rubix Cube House, Elevation House (2003) présentent des structures adaptables à des environnements urbains étroits, contraignants et coûteux : un système d'élévateur ou de trappe murale permet de faire apparaître ou disparaître un lit, une table ou une pièce entière... Mais l'artiste n'entend pas pour autant trouver des solutions fonctionnelles aux problèmes que rencontrent l'architecte ou le designer. Quand Blum indique les fonctions des modules de sa Nomadic House ("manger, habiter, travailler"), l'approche se veut ironique et le questionnement critique. Il est d'ailleurs possible d'y lire une réponse à l'affirmation de Donald Judd :
"L'art de dessiner une chaise n'a rien à voir avec la conception d'une œuvre d'art (…) La dimension artistique d'une œuvre d'art vient en partie de l'affirmation d'un individu, sans qu'on tienne compte d'autres considérations. Une œuvre d'art existe en soi ; une chaise existe en tant que chaise" (24).
Judd séparait catégoriquement le design (vu comme une création de mobilier) et l'art. Aujourd'hui, les frontières sont beaucoup moins étanches et les catégories fluctuantes. Lorsque Blum réalise La chambre de Christophe Durand-Ruel (1996) dans le domicile personnel de celui-ci, elle pense l'aménagement comme une œuvre d'art et non comme un exercice de décoration. Lorsque Jorge Pardo expose sa maison, comme une sorte de dépendance du Musée d'art contemporain de Los Angeles en 1997, plus personne ne sait s'il s'agit d'un espace d'habitation privé ou d'un objet d'exposition. Les idées d'autonomie de l'art, de personnalité irréductible de l'artiste, la dichotomie entre majeur (high) et mineur (low) qui structurent la hiérarchie entre art plastiques et arts appliqués sont très fortement mises à l'épreuve.
CHANGEMENTS D'ÉCHELLE ET DE NATURE
Comme bien des jouets, les maisons pour enfants, en tissus ou en plastique, ont également fait l'objet de détournements artistiques. En 1998, le danois Henrik Plenke Jakobsen s'est emparé d'une maisonnette en plastique coloré pour réaliser sa Laughing gaz house où les amateurs étaient conviés à inhaler des bouffées d'oxygène. Dans La Città (1994), Liliana Moro présentait un ensemble de maquettes de maison pour enfants, reliées les unes aux autres par des guirlandes électriques qui s'allumaient par intermittence. Chacune de ces œuvres remet en question l'aspect normatif de la maison dans les jeux d'enfant.
Le changement d'échelle inhérent au jouet peut également provoquer des effets inverses lorsque l'adulte essaye de repenser la maison à partir de la taille d'un enfant : dans l'installation Das Zimmer que Pipilotti Rist présenta à la Biennale de Lyon en 1997, le visiteur était convié à entrer dans un salon surdimensionné pour s'asseoir sur un canapé géant (une fois assis, impossible de toucher le sol). Il était également possible de changer les programmes de la télévision à partir d'une énorme télécommande.
Malgré cela, le principe de réduction prévaut. Pour des raisons conceptuelles, pédagogiques ou économiques, il semble en effet plus simple de réaliser une maquette (même s'il s'agit de régler une œuvre monumentale). La position dominante du regardeur face à un modèle réduit -ce que Jean-Louis Cohen nomme "l'effet Gulliver" (25)- pourrait expliquer l'étrange envahissement des maquettes d'architecture ou d'urbanisme dans les musées. Les petites maisons qui se sont multipliées de façon exponentielle dans l'art contemporain appartiennent à deux registres assez différents : elles peuvent être entendues comme des études préparatoires ou comme des fins en soi, elles peuvent surgir de façon sporadique dans l'œuvre d'un artiste ou au contraire se situer au cœur d'une recherche personnelle complexe (pensons par exemple aux maquettes de Thomas Schütte, Siah Armajani, Allen Wexler, Didier Marcel…).
Certains artistes se sont emparés du modèle réduit pour remettre en question la politique de logement d'une ville ou d'une région. L'artiste brésilien Cildo Meireles a posé le problème de l'habitation sociale dans les grandes villes en laissant la maquette d'un logement social à l'emplacement où le permis de construire lui fut refusé (Glasgow/Ghost house, 1990). Au Centre Régional d'Art Contemporain de Sète, Alain Declercq a plongé soixante maquettes de pavillons individuels formant un lotissement dans un bassin de 150 m2 d'eau boueuse, dénonçant ainsi la vente de terrains et de constructions en zones inondables (Le village idéal (noyé), 2001).
Dans leur exposition de Maisons présentée au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris en 1999, Rosemarie Trockel et Carsten Höller ont eu recours à des maquettes pour suggérer de nouveaux types d'habitations destinées aux enfants, aux animaux et aux humains. Les titres sont révélateurs : Maison pour pigeons, humains et rats, Maison pour cochons et enfants…L'entomologie, dont Höller est un spécialiste, semble avoir servi de prétexte pour mettre en œuvre un principe comparatiste plutôt violent : tandis que la première maquette d'habitation (pour pigeons) évoquait un vaisseau spatial de type futuriste, l'autre (pour cochons) présentait une structure en métal comparable à celle qui mène les animaux à l'abattoir et une vidéo montrant un porc. Avant cela, en 1997, une autre maison pour les cochons et les hommes fut exposée par les deux artistes à la Documenta X de Kassel. Cette fois là, le public était convié à entrer et à s'installer confortablement pour observer les agissements d'une famille de porcs enfermée dans un enclos. Perçue comme une critique acerbe de l'instinct grégaire du public des grandes manifestations artistiques, cette maison a suscité de vives protestations. Même chose à Paris où la SPA s'est émue du traitement infligé à certains animaux dans l'exposition !
Le musée, le centre d'art, la galerie d'exposition ne jouent évidemment pas les mêmes rôles. Mais ils ont ce point commun d'être suffisamment élastiques pour englober et digérer les valeurs transgressives de l'art. Cette assimilation qui est propre à "l'esprit du capitalisme", génère souvent une aseptisation de la dimension critique de l'œuvre. Elle suscite la méfiance de certains artistes, dont le but est de se situer à la fois dedans et en dehors de l'institution, dans la marge et en plein cœur du processus de sélection et d'élection des œuvres d'art. Dès lors, comme on le voit avec Thomas Hirschhorn, le mythe de la maison-musée est battu en brèche.
Dès qu'il le peut Hirschhorn sort des lieux d'exposition traditionnels pour se confronter à un public qui ne visite pas les biennales, les galeries d'exposition, ni même les grands musées. Lors de la Documenta XI en 2002, il fit le choix de présenter son Bataille Monument entre les immeubles d'une cité de la banlieue de Kassel. Avec les habitants, il a réalisé une sculpture monumentale disposée sur un socle, puis il a mis en place différents "abris" précaires dont un studio vidéo et une sorte de maison de la culture (qui prêtait par exemple des ouvrages de Nietzsche et de Bataille ainsi que des vidéos érotiques). En créant les possibilités d'un processus de rencontre hors du champ muséal, hors du principe de pérennité des œuvres, l'artiste souhaite résister à "la pression de la norme". De fait Les Monuments aux grands hommes sont voués à la démolition. Ils sont détruits après leur exposition, exactement comme les sculptures que les dadaïstes berlinois présentèrent à la Erste Internationale Dada-Messe (Première Foire Internationale dada) en 1920. Les photos et les enregistrements vidéos sont donc les seules traces tangibles de l'action menée par Hirschhorn pendant plus de six mois dans cette banlieue allemande. Ce processus de sauvegarde qui permet de documenter l'évolution de l'installation n'est pas en soit une nouveauté. Il suffit d'évoquer le rôle majeur des constats photographiques et vidéographiques pour l'historisation du Land art, du Body art ou de l'Actionnisme viennois. Tous ces artistes se sont érigés contre le musée, le centre d'art et la galerie. Ils ont vécu -parfois fort mal- de leur pouvoir d'opposition et de leur faculté à repousser les limites du raisonnable.
Diffuses, hétérogènes et changeantes, les pratiques contemporaines sont difficiles à cerner mais leurs charges offensives peuvent être frontales et directes, comme au temps de Dada ou de Fluxus. Tandis que les installations d'objets et les environnements construits prolifèrent dans l'art du monde entier, les frontières entre les disciplines sont de plus en plus vagues et les compétences des artistes de plus en plus élargies. L'avant-garde comme structure idéologique et sociale n'existe plus, mais une certaine forme d'offensive contre le "prêt à penser" est toujours vivace. Tout porte à croire que l'art n'existera plus lorsque l'activité artistique sera simplement assimilée à une prestation de services, parfaitement en phase avec la société tertiaire où il s'inscrit. De ce point de vue, l'irruption de la maison dans la musée, dont les formes sont récurrentes et variées (installations, environnements construits, iconographie, maquettes) est un symptôme de la crise identitaire du sujet face à une société qui produit, stocke, conserve et archive des milliers d'objets mais c'est aussi l'expression d'un désir transgressif vital.
(1) Citons par exemple la chambre rétro d'Edouard Kienholz Tandis que des visions de prunes confites dansent dans leur têtes (1964), Le Bedroom Ensemble de Claes Oldenbourg (1969) revisité par Sylvie Fleury dans une version en fourrure synthétique en 1997, La chambre de Judie avec sa peinture et sa vidéo installées par David Reed (1992), les chambres-portraits dédiées à des personnalités ou encore La chambre orange de Dominique Gonzalez-Foerster (1992), La chambre de la mariée de Philippe Mayaux (2003)... D'autres propositions impliquent une véritable participation du spectateur : l'Hôtel passager (1998) que Martine Aballéa installa à l'ARC proposait des chambres gratuites, à réserver exclusivement la journée. En Suède, à Malmö, le duo hollandais Bik Van der Pol proposait de passer deux nuits et trois jours au Rooseum, en regardant -entre autres- le film Sleep de Warhol (Sleep with me, 2003). Plus provocateur et ambigu, Le Lovehotel de Jota Castro était installé dans la galerie Maisonneuve (Paris), transformée pour l'occasion en chambre équipée de documentations et autres objets pornographiques à louer pour une plusieurs nuits…
(2) "Habiter l'exposition" était le titre d'une exposition au MAC de Marseille en 1999.
(3) Thomas Crow, "Modernisme et culture de masse dans les arts visuels", Les Cahiers du MNAM n°19-20, juin 1987, p.20. Dans cette conférence prononcée à l'Université de British Columbia en 1981, Crow discernait l'avant-garde et le modernisme qui est "une pratique artistique autonome, centripète et autocritique".
(4) cf. Philippe Cuenat, "Portraits de groupes et de scènes de genre, l'exposition "relationnelle" comme représentation de la société libérale", numéro spécial de la revue art press, Oublier l'exposition, 2000, p. 76-82. Cuenat émet l'hypothèse que ces situations communicationnelles qui se sont développées dans les années 90 pourraient "illustrer" des nécessités institutionnelles comme celle de "la gestion des publics" et l'installation de "zones de communication". Et si elles en étaient tout simplement la conséquence ?
(5) Roland Barthes, "Cette vieille chose, l'art", in L'obvie et l'obtus, Essais critiques III, Seuil, 1982, p.182.
(6) "Entretien de Louise Bourgeois avec Suzanne Pagé et Béatrice Parent" en 1995, in Destruction du père, reconstruction du père , écrits et entretiens, 1923-2000, Daniel Lelong éditeur, 2000, p. 312.
(7) Pour cette citation et la précédente, cf. Georges Hugnet, Dictionnaire du dadaïsme, Jean Claude Simoën, p. 236-239.
(8) cf. Sarah Wilson, "Schwitters en Angleterre", catalogue de l'exposition Kurt Schwitters, Musée National d'Art Moderne, 1994-1995, p. 296-309.
(9) En 1988, J.P Raynaud décida de suspendre les visites de sa maison. Pendant les cinq années qui précédèrent sa destruction, il fut le seul à pouvoir en franchir le seuil, cf. Marc Sanchez, J.P Raynaud, La maison, CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux, 1993, p.9.
(10) Termes employés par J.P Raynaud, la crypte étant même l'une des pièces de la maison avec la chambre, la serre et la tour, cf. Marc Sanchez, J.P Raynaud, La maison, op. cit.
(11) De la même façon, Les cellules étroites et austères d'Absalon constituaient des environnements parfaitement autonomes à mi chemin entre "le sarcophage, la navette spatiale et l' abri anti-atomique". Chacune des cellules était une sorte d'unité de survie, un espace de solitude entièrement peint en blanc, à partir d'une base en bois et carton. Chacune résultait d'une nécessité intérieure et répondait à une angoisse très personnelle. cf. Architecture(s), catalogue de l'exposition au CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux, 1995, p. 47
(12) Sur le thème de la "maison-portrait", cf. Marie-Ange Brayer, "La maison, un modèle en quête de fondation", Exposé n°3, 1997, p.27.
(13) Dans son célèbre essai sur "L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique", Walter Benjamin émet l'hypothèse que "le dadaïsme cherchait à produire, par les moyens de la peinture (ou de la littérature) les mêmes effets que le public demandait au cinéma", in L'homme, le langage et la culture, Essais Flammarion, 1971, p. 173.
(14) Il n'est pas inutile de rappeler que les artistes britanniques de l'Independant Group furent très intéressés par les collages de Schwitters et que Richard Hamilton intervint personnellement pour sauver le Merzbarn qui fut installé en 1965 à l'Université de Newcastle-upon Tyne, cf. Sarah Wilson, op. cité, p. 306.
(15) cf. Dan Graham, œuvres 1965-2000, catalogue de son exposition au MAMVP, 2001 p. 104-105.
(16) Pour illustrer le slogan "Notre sincère désir est votre plaisir", les cartes postales de la John Hinde Studio avaient nécessité le recours à des centaines de figurants. Soigneusement agencées, ces photographies couleur de clubs de vacances irlandais montraient des moments de convivialité, de loisirs et de détente qui s'accordaient assez mal avec la rigueur impeccable des bâtiments préfabriqués, cf. Notre sincère désir est votre plaisir, cartes postales de John Hinde présentées par Martin Parr, éditions Textuel, 2002.
(17) cf. "Bruit de fond", Journal n°7 du Centre National de la Photographie, décembre 2000, p.5.
(18) Il n'est pas inutile de rappeler que Gordon-Matta Clark était le fils du peintre surréaliste Matta et un proche de Marcel Duchamp jusqu'à la mort de ce dernier en 1968. Sa première intervention "destructrice" eut lieu dans un immeuble désaffecté du Bronx où il découpa des formes quadrangulaires dans les murs, les sols et les plafonds d'appartements situés à différents étages. Des photos ainsi que des fragments du building furent ensuite exposés, cf. Thomas Crow, Gordon Matta-Clark, Phaidon, 2003, p.58-92.
(19) Marie-Ange Brayer, "La maison, un modèle en quête de fondation", op.cit, p.48.
(20) cf. Beatriz Colomina, "Le mur divisé : le voyeurisme domestique" in Exposé n°3, op. cit. p.114-115.
(21) Marie-Ange Brayer, Béatrice Simonot, Archilab, Orléans, 2001, p. 138.
(22) Franco Borsi, Architecture et utopie, Hazan, 1997, p. 18.
(23) cf. Ranti Tjan, "The return of the Prototype", Futuro, Tomorrow's house from Yesterday, Toimittaneet, Marko Home & Mika Taanila, Helsinki, 2002, p. 48-53.
(24) Donald Judd, "A propos du mobilier", Möbel Furniture, Zürich, 1986, reproduit in Donald Judd, Ecrits, 1963-1990, Daniel Lelong éditeur, 1991, p. 182-185.
(25) Jean-Louis Cohen, "Maquettes d'architecture, usages et usure", Oublier l'exposition, op. cit. p. 54-55.
Inscription à :
Articles (Atom)
Articles les plus consultés
-
Francis Picabia, les nus, les photos, la vie... (1938-1949) Article traduit en anglais et allemand dans le catalogue de l’exposition Picab...
-
« La peinture dans le champ élargi », conférence, Le Plateau, Paris, 13 novembre 2003. En consultant le plan, on voit des formes géométri...
-
"Surréaliste et merveilleux jusqu'à un certain point...". Publié dans le catalogue de l'exposition L'homme merveilleux...
-
"Tetsumi Kudo, portrait de l’artiste dans la crise". Rétrospective à la Maison rouge, Paris. Publié dans Art press n° 331, févrie...
-
Wim Delvoye, Esquisse préparatoire pour D11 , 2007 "Monter/démonter, Wim Delvoye et l’art des cathédrale", publié dans L’Art de l’...
-
Communication lors du symposium « Picasso, un poète qui a mal tourné », organisé par Serge Linarès (Université Sorbonne Nouvelle), An...
-
«L'effet boomerang de la danse», article publié dans Art press n° 389, mai 2012, p. 59-65. La rencontre est improbable : ce printemps...
-
"Picabia et Picasso, la reproduction des monstres", conférence lors du colloque Rire avec les monstres, caricature, étrangeté et f...
-
Catalogue d'exposition Amitiés et Créativité collective , Marseille, Mucem, 2022 Œuvre collective initiée par le peintre et poète Fr...
-
Publié dans Les mots de la pratique , dits et écrits d'artistes , tome 2, sous la direction de Christophe Viart, Le mot et le reste, 202...